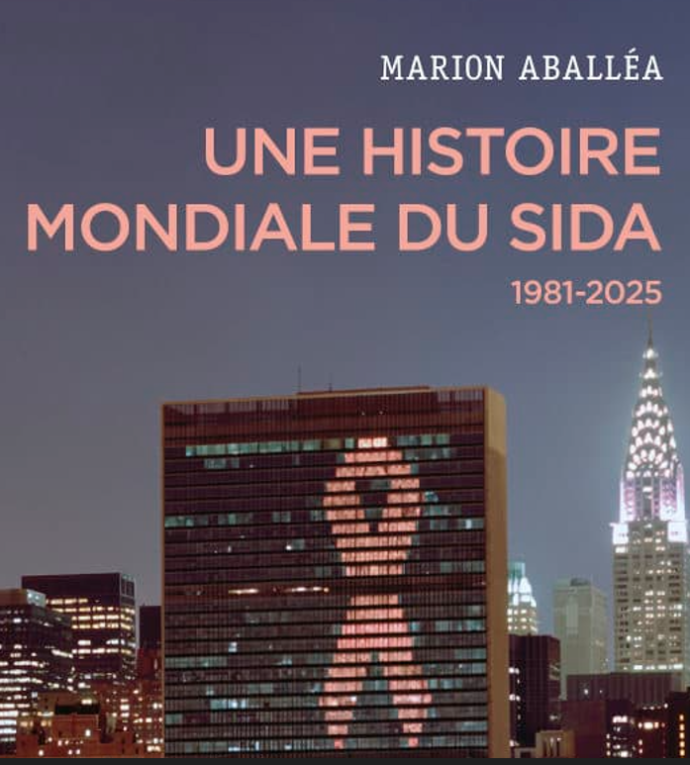Selon le Fonds mondial, 27 millions de vies ont été sauvées grâce à ses investissements. Créé en 2002, à l’initiative des membres du G7, et basé à Genève, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme est une organisation qui finance des programmes de lutte contre ces trois pandémies pour une durée de trois ans renouvelables dans les pays qui en font la demande. Parmi eux, les pays d’Afrique subsaharienne (65% des projets) et d’Asie et Pacifique (19%), mais aussi d’Europe de l’Est et Asie centrale (4%), d’Afrique du Nord et Moyen-Orient (8%) et d’Amérique latine et Caraïbes (4%).
Un nouveau cycle s’ouvre
Le Fonds mondial est financé selon des cycles de trois ans, dont le cinquième couvre la période 2017-2019. Pour ces trois années, l’organisme a reçu plus 12,9 milliards de dollars en promesses de dons. Ses principaux donateurs sont les États-Unis, qui le financent à hauteur d’un tiers (4,3 milliards de dollars), le Royaume-Uni (1,1 milliard d’euros), la France (1,08 milliard d’euros), l’Allemagne (810 millions d’euros) et le Japon (800 millions de dollars). S’ajoutent d’autres pays du Nord, des donateurs privés (à hauteur de 6,5%, principalement la fondation Gates), ainsi que des pays par ailleurs bénéficiaires du Fonds, dont l’Inde, la Chine, le Nigeria, l’Afrique du Sud et le Kenya.
L’année 2019 est celle d’un rendez-vous crucial pour le Fonds mondial : l’ouverture d’un sixième cycle, couvrant la période 2020-2022. Pour la première fois, la réunion de reconstitution, grande rencontre des donateurs au cours de laquelle ils annonceront leurs promesses de dons pour les trois années suivantes, aura lieu en France, à Lyon, le 10 octobre 2019.
Ces promesses seront-elles à la hauteur des besoins du Fonds ? À ce jour, les financements ont toujours été en hausse d’un cycle à l’autre, passant de 3,73 milliards de dollars pour le premier cycle (le seul de deux ans, 2006-2007) à plus de 12,9 milliards de dollars pour le cinquième – à l’exception d’une stagnation du quatrième cycle par rapport au troisième, autour de 12 milliards de dollars. Mais avant de connaître les offres des États, il s’agit de déterminer les besoins à venir.
Le Fonds mondial les fera connaître au terme de sa réunion préparatoire, qui aura lieu à New Delhi (Inde), le 8 février 2019. Calculés en fonction des données épidémiologiques des trois pandémies, ces besoins devront inscrire l’action du Fonds mondial sur la trajectoire des objectifs de développement durable, définis en 2015 par l’Organisation des Nations unies (ONU). Parmi ces 17 cibles, la troisième, relative à la santé, prévoit entre autres de « mettre à fin à l’épidémie de sida » d’ici à 2030.
Des besoins en hausse
Si nul ne se risque à des pronostics sur la somme que demandera le Fonds, la directrice exécutive des Amis du Fonds mondial Europe, Sylvie Chantereau, avance qu’« elle sera plutôt en hausse, en raison des nouvelles infections et du nombre croissant de personnes sous traitement ». Autre soutien du Fonds mondial, l’association Global Fund Advocates Network évoque, sur la base de ses propres calculs, des besoins compris entre 16,8 et 18 milliards de dollars. « La méthodologie du Fonds mondial n’est pas la même, nous n’aurons pas nécessairement la même estimation », tempère Françoise Vanni, directrice des relations extérieures du Fonds mondial.
Fait rare dans le domaine de l’aide internationale, les demandes du Fonds mondial ont toujours été quasiment comblées. Qu’en sera-t-il cette fois-ci ? La réponse paraît moins évidente que lors des cycles précédents, tant la situation politique mondiale a évolué : élection de Donald Trump aux États-Unis, Union européenne déstabilisée par le Brexit, tentations de repli national… autant de menaces sur l’aide sanitaire internationale.
Fait rare dans le domaine de l’aide internationale, les demandes du Fonds mondial ont toujours été quasiment comblées. Qu’en sera-t-il cette fois-ci ?

Or, contre toute attente, les diverses personnes interrogées ne s’inquiètent pas outre mesure pour le Fonds mondial : « la dynamique politique ne nous atteint pas forcément de manière immédiate », constate Françoise Vanni. Au Congrès américain, le dossier sur le Fonds mondial fait l’objet d’un solide compromis transpartisan entre démocrates et républicains. Cet attachement à la lutte contre le sida a d’ailleurs été rappelé dans un courrier envoyé mi-octobre par 18 sénateurs américains au secrétaire d’État Mike Pompeo, lui demandant d’accroître l’aide des États-Unis au Fonds.
Du côté français, la plupart des personnes interrogées s’attendent, a minima, à un maintien de la dotation actuelle, de 1,08 milliard d’euros sur trois ans (360 millions d’euros par an), la même depuis le troisième cycle (2011-2013). Plusieurs signes s’avèrent toutefois encourageants : premièrement, le fait que la France accueille la réunion de reconstitution. Deuxièmement, la promesse faite par Emmanuel Macron d’augmenter l’aide publique au développement (APD) française, bien que très en deçà de l’objectif onusien de 0,7% du revenu national brut (RNB). De 0,43% du RNB en 2017, l’APD française devra être portée à 0,55% du RNB en 2022, a promis le président français. Une montée en puissance qui coïncide fort bien avec le sixième cycle : parmi les dirigeants du G7, « Emmanuel Macron est celui qui a la plus grande marge de manœuvre », espère Khalil Elouardighi, directeur du plaidoyer de Coalition Plus, une union internationale d’associations de lutte contre le sida et les hépatites.
Également scrutée, la participation britannique : le Royaume-Uni est l’un des rares pays du Nord à remplir l’objectif de 0,7% du RNB. Le pays maintiendra-t-il ce niveau alors qu’il divorce de l’Union européenne ? « Fort probablement, estime Khalil Elouardighi, le pays n’a pas la volonté de revenir sur son APD, il ne peut pas se permettre d’être moins présent en Afrique. » Quant à l’Allemagne et au Japon, il confie ne « pas avoir d’inquiétude particulière » sur leur niveau de financement.
La santé mondiale, nouvel horizon
À ces attentes triennales qui caractérisent la vie du Fonds mondial se greffe une autre préoccupation, celle de la santé mondiale (Global Health en anglais). À quelques jours de la 22e Conférence internationale sur le sida, qui s’est tenue fin juillet à Amsterdam, un groupe d’experts du sida a publié, dans la revue médicale britannique The Lancet, un copieux article sur ce sujet.
Les auteurs partent d’un constat simple : la lutte contre le sida, si elle est loin d’être gagnée, constitue un succès sans précédent en termes de santé publique. Or d’autres maladies, dont l’obésité, le diabète, les cancers et les maladies cardiovasculaires, font rage dans les pays du Sud, sans retenir autant d’attention. Pour ces maladies non transmissibles, la situation n’est pas sans rappeler celle du sida dans les années 1990 : traitements disponibles au Nord, mais peu ou pas accessibles au Sud. Ainsi, un pays africain sur deux ne dispose pas de centre de radiothérapie pour traiter les cancers. À peine plus avancée, la lutte contre les hépatites virales et les infections sexuellement transmissibles (IST), fréquemment associées à l’infection par le VIH, reste aussi à la traîne.
Dès lors, comment articuler la lutte contre les trois pandémies tout en répondant à ces autres besoins médicaux, bien moins dotés financièrement ? Comment renforcer les systèmes de santé des pays du Sud afin qu’ils répondent à l’ensemble des besoins ? Selon Stéphanie Tchiombiano, coordinatrice du de Santé mondiale 2030, un groupe de réflexion français mis en place en 2016, « la lutte contre ces maladies nécessitera une approche globale, et non plus une approche par silos ». Dans la lutte contre le VIH, « cette verticalité a été une très bonne chose, elle a permis d’atteindre des résultats que l’on pensait inatteignables. Mais la situation a changé, et les défis ne sont plus exactement les mêmes : on ne peut plus s’occuper du VIH sans des systèmes de santé plus forts », explique-t-elle.
Verticalité versus horizontalité ?
Pour autant, l’opposition entre une verticalité de la lutte contre le VIH/sida et une horizontalité privilégiant les systèmes de santé paraît artificielle. Exemple : les financements consacrés à la lutte contre le sida ont permis la mise en place de laboratoires médicaux, profitables à d’autres patients que ceux infectés par le VIH, notamment pour diagnostiquer d’autres IST ou les cancers du col de l’utérus. Et les succès médicaux engrangés contre le VIH (amélioration de la santé des patients, trithérapie en un comprimé quotidien, etc.) ont permis de désengorger les centres de soins, au profit d’autres maladies.
Selon Françoise Vanni, « il faut sortir de ce faux dilemme entre verticalité et horizontalité : il y a une interdépendance très forte entre la lutte contre les trois pandémies et le renforcement des systèmes de santé. D’ailleurs, 28% des fonds alloués par le Fonds mondial contribuent à cela, que ce soit en termes de ressources humaines, de systèmes d’approvisionnement ou pour la collecte et l’usage de données sanitaires ».
Plutôt qu’un choix cornélien entre l’exceptionnalisme du VIH et une dilution dans la santé mondiale, une troisième voie existe : celle d’un essaimage à partir de la lutte contre le VIH, riche en succès médicaux et sociaux. L’article du Lancet souligne d’ailleurs l’importance de cet héritage, dont l’éducation thérapeutique, le respect des droits humains et la place importante accordée à la société civile, mise sur un pied d’égalité avec les scientifiques et les politiques. « La lutte contre le sida a été révolutionnaire, notamment sur la question des patients experts, juge Stéphanie Tchiombiano, elle peut constituer une source d’inspiration pour les maladies non transmissibles. »

Les financements consacrés à la lutte contre le sida ont permis la mise en place de laboratoires médicaux, profitables à d’autres patients que ceux infectés par le VIH
Une offre multimaladies
Pour la prise en charge pratique des patients, l’une des voies envisagées est celle du « one-stop shop », à savoir la possibilité pour les personnes de couvrir leurs besoins médicaux en un seul point. Exemple au Kenya, où des bus sillonnant le pays présentent une offre multimaladies (VIH, tuberculose, diabète, hypertension). Selon l’article du Lancet, dépister 10% de la population sud-africaine chaque année grâce à ces bus permettrait de dépister un total de 492 000 cas d’infection par le VIH, 1,21 million de cas de diabète et 6,35 millions de cas d’hypertension sur la période 2018-2028. En raison des effets préventifs du traitement anti-VIH, cette stratégie permettrait d’éviter 69 000 infections sur ces dix années.
Reste à savoir comment financer ces missions de lutte contre d’autres maladies. Est-il envisageable d’élargir le mandat des organisations spécialisées dans le VIH ? Attachée à la « flexibilité du Fonds mondial », Sylvie Chantereau juge que « s’il fallait s’occuper d’autres maladies, il faudrait que les financements suivent. À financement constant, cela n’aurait aucun sens. Nous devons nous assurer d’avoir les ressources pour garantir le mandat du Fonds mondial ». Même constat à Unitaid, organisation internationale d’achats de médicaments. Selon son directeur adjoint, Philippe Duneton, « on ne peut pas faire tout et n’importe quoi, nous restons focalisés sur les trois maladies, tout en essayant de comprendre ce que notre action peut faire de manière systémique ». Quitte à « sortir du cadre », par exemple en agissant contre l’hépatite C et le cancer du col de l’utérus, mais « toujours à partir des trois pandémies », ajoute-t-il.
Défendre les droits humains
Du côté des associations, on craint que le concept de santé mondiale, en diluant la lutte contre le VIH, ne gomme certains de ses acquis. « S’occuper des droits des personnes, dont les usagers de drogues injectables, les homosexuels et les travailleur·euse·s du sexe, sera-t-il toujours possible dans ce nouveau contexte global ? » s’interroge Nicolas Ritter, directeur de l’association mauricienne Pils. Selon lui, il faut bien évidemment « faire avec la santé mondiale, mais les patients doivent rester au cœur de la réponse ».
Si la santé mondiale peut permettre d’étendre les succès engrangés contre le VIH, certains craignent qu’elle n’entraîne mécaniquement une baisse des subventions aux associations de lutte contre le sida. Ce qui serait particulièrement problématique dans les pays à revenu intermédiaire. Par exemple, au Maroc, pays « en bas de liste du Fonds mondial », explique Mehdi Karkouri, président de l’association marocaine ALCS. « Dans des pays comme le Maroc, l’argent du Fonds mondial ne sert pas à payer les traitements [une dépense assurée par l’État, NDLR], il finance surtout la prévention : si le Fonds mondial part [du Maroc], la prévention part aussi. Face à une opinion publique conservatrice, le gouvernement marocain n’acceptera jamais de payer la prévention chez les gays », craint Mehdi Karkouri. Au risque de voir l’épidémie repartir à la hausse.
 2019, quel avenir pour le Fonds mondial?
2019, quel avenir pour le Fonds mondial?