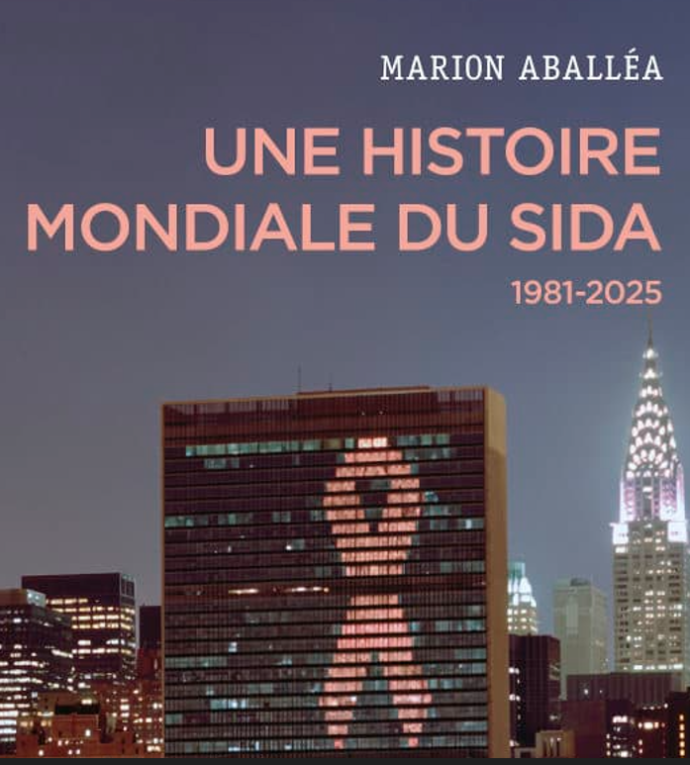Au Kazakhstan, une épidémie secrète

Indira Otzhanova, 35 ans, accoudée sur son canapé, raconte calmement l’année 2006. Celle qui a changé sa vie. « Mon fils Dastan avait 6 mois. Il avait une bronchite, je l’ai emmené à l’hôpital. » Dans les mois qui suivent, il attrape une pneumonie. Sa santé se dégrade, elle est inquiète. Au bout de plusieurs mois, les médecins lui disent de faire tester son fils pour le VIH. Le test est positif. « Je ne comprenais pas. Pendant ma grossesse, j’avais fait un test, il était négatif. » Trois semaines après le test de Dastan, elle en fait un à son tour. Positif également. Elle comprendra vite que son fils a d’abord contracté le VIH à l’hôpital, où une infirmière a utilisé une seringue à usage unique sur plusieurs enfants, dont Dastan. Indira a été, elle, infectée après la naissance de son fils.
En 2006, 149 enfants ont été infectés dans des hôpitaux pour enfants de la région de Shymkent, dans le sud du pays. En juillet, quand le drame devient public, 13 000 enfants passés par l’hôpital en début d’année seront testés pour le VIH. Le gouvernement missionne le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), basé à Almaty, de mener une enquête sur les causes de l’infection. Dans un article qui date de 2007[1], Michael Favorov, à la tête de l’enquête de la CDC, explique qu’« immédiatement, nous avons identifié que le problème principal était la transfusion de sang ». À l’époque, les centres de récolte de sang font appel à l’industrie du sang, entre autres à des usagers de drogues par injection, sans toujours vérifier la qualité du sang ni celle du plasma. Dans les hôpitaux, un système de marché noir s’est développé. Les médecins proposent des transfusions sanguines aux patients, pas toujours nécessaires, mais sur lesquelles ils prennent une commission financière. Cela n’étonne pas Michel Kazatchkine, conseiller spécial du programme commun des Nations unies sur le VIH/sida pour l’Europe de l’Est et l’Asie centrale : « À l’époque, une seringue jetable pouvait être utilisée sur 30 enfants. Et les pays postsoviétiques traitaient tout par injection, angines et autres maladies. »
Des réactions immédiates
À cette période, « en Asie centrale et en Europe de l’Est, les infections étaient essentiellement nosocomiales. [transmises à l’hôpital, NDLR] Il y avait peu de matériel de stérilisation, et le budget ne permettait pas d’avoir de matériel jetable », ajoute Michel Kazatchkine. Treize ans après la chute de l’URSS, l’économie kazakhe est à terre, le système de santé publique aussi. Des infections similaires ont eu lieu au Kirghizistan, en 2007 et 2008, et en Uzbekistan, en 2008, mais le gouvernement kazakh est le seul à avoir pris des mesures aussi radicales suite au drame. Quatre banques de collecte de sang seront immédiatement fermées. En septembre 2006, le ministre de la Santé et le gouverneur de région sont écartés. Vingt et une personnes, personnel médical et officiels, seront jugées pour négligence et corruption, 16 feront de la prison. Chaque famille recevra environ 800 dollars et le traitement de toutes les victimes sera pris en charge à vie.
Aigul Kadirova, qui gérait alors le programme de développement de la jeunesse et la prévention du VIH de l’Unicef, se souvient : « Face à l’ampleur de l’épidémie, à Shymkent, les médecins étaient démunis. » À cette époque, le VIH n’était pas répandu au Kazakhstan et touchait surtout les usagers de drogues par injection, une population très marginalisée qui ne recourait pas aux soins. Le gouvernement missionne l’Unicef qui, en octobre 2006, fait venir des experts du VIH pédiatrique d’Ukraine et de Russie. Un centre VIH pour mère et enfants sera ouvert dans la foulée. « Depuis, reprend Aigul Kadirova, les médecins du Sud du Kazakhstan sont souvent considérés comme les experts de la région sur le VIH pédiatrique ».
Un tabou qui entretient l’épidémie
Contacté, le ministère de la Santé kazakhe assure que le système hospitalier a été complètement rénové et renforcé, qu’il n’y a pas eu d’autre cas d’infection enregistré dans un organisme médical. « Aussi, des efforts considérables ont été réalisés ces dernières années par le Kazakhstan, notamment au niveau de la thérapie antirétrovirale et du soin », reprend Michel Kazatchkine. C’est aussi le seul pays de la région à financer lui-même le traitement antirétroviral. Malgré ces avancées, le Kazakhstan compte 25 000 à 30 000 personnes vivant avec le VIH[2], un nombre peu élevé, mais celui des nouvelles infections peine toujours à baisser. À ses yeux, c’est à cause du tabou qui règne autour des populations marginalisées, chez lesquelles le virus circule toujours : usagers de drogues, homme ayant des rapports sexuels avec des hommes, travailleuses du sexe. Dans une culture qui mêle Islam et ex-URSS, ces populations marginalisées ne vont pas recourir à des soins ou se faire tester. « Tant qu’un réservoir existera, dans lequel des populations, cachées, ne connaîtront pas leur statut, l’épidémie continuera », conclut Michel Kazatchkine.
[1]Ivan Watson, “Trial Scrutinizes Infant HIV Outbreak in Kazatkshtan”, NPR, Mars 2007 : npr.org/templates/story/story.php?storyId=8954147&t=1559629442792
[2]Unaids.
 Au Kazakhstan, une épidémie secrète
Au Kazakhstan, une épidémie secrète