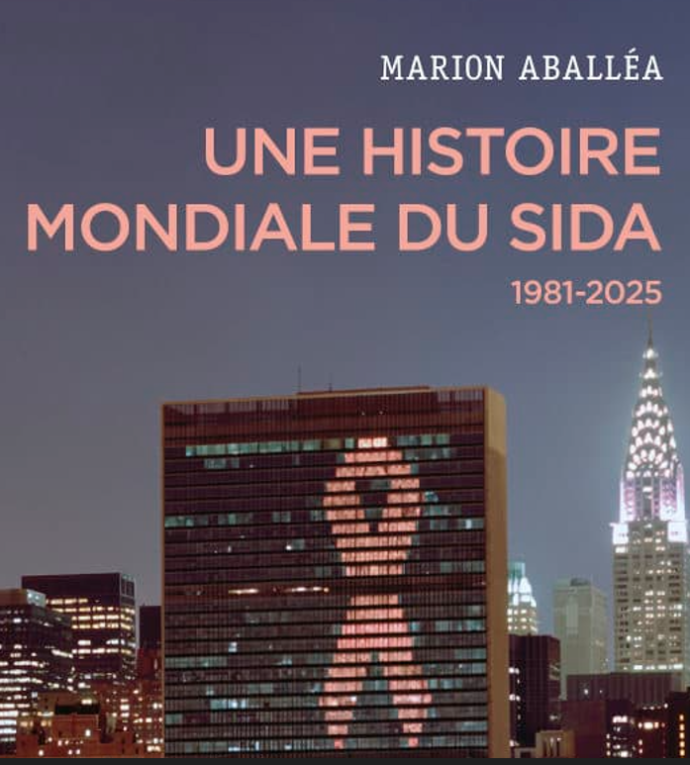Entretien avec Anicet Zran, historien, enseignant chercheur au département d’histoire de l’université Alassane Ouattara de Bouaké, spécialiste du VIH/sida en Côte d’Ivoire.







Vos travaux portent sur les discours et les politiques liés au VIH-sida en Côte d’Ivoire. A quelle occasion vous-êtes vous penché sur ces questions ?
Cette épidémie a frappé de plein fouet la Côte d’Ivoire. Je me suis intéressé à cette question à partir de la déclaration du Pape Benoît XVI au mois de mars 2009, lors de sa première visite en Afrique. Il avait déclaré que le problème du sida en Afrique ne pouvait pas être résolu par l’utilisation de préservatifs et que leur distribution aggravait le problème. Ces propos avaient suscité une levée de boucliers de la part des organisations de lutte contre le sida et créé un débat dans la société ivoirienne. Fin 2009, le débat persistait. Le Pape avait jeté un pavé dans la mare et semé la confusion dans les esprits. La question du « préservatifs business » avait émergé et j’ai cherché à comprendre ce qui se passait. Pourquoi avait-il tenu ces propos ? Quel était ce débat ? Où en étions-nous avec le sida ? Je me suis posé ces questions d’autant plus que la Côte d’Ivoire est le moteur de l’espace économique Ouest Africain, un pays important dans l’espace de la CEDEAO, la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest, mais aussi le pays qui avait été le plus durement touché par le VIH-sida, avec un taux de prévalence qui approchait celui des pays connus comme étant des foyers de propagation de l’épidémie, le Kenya et l’Ouganda par exemple. Mon travail a évolué et j’ai compris comment les choses s’étaient passées au tout début de l’épidémie. En Côte d’Ivoire, les premiers cas « officiels » remontent à 1985. Mais avant ces premiers cas, le service des maladies infectieuses recevait déjà des patients, dès 1982 ou 1983, qui présentaient des signes cliniques qui n’étaient pas encore associés au VIH-sida : diarrhées, amaigrissement, toux, fièvres de longue durée. En octobre 1985, l’OMS a réuni des experts africains à Bangui pour la définition des signes cliniques associés au sida, en l’absence de tests de dépistage. C’est ce qu’on a appelé le « score de Bangui » : à partir de quelques signes, un score est établi sur une échelle de 12 points, et à chaque signe est attribué un nombre de points allant d’un à quatre, en fonction de sa gravité. Les dossiers des malades ont été revus, et on s’est rendu compte que l’épidémie était déjà là. Le premier malade « officiel », un cadre d’une société privée pétrolière, était hospitalisé au service des maladies infectieuses. Voyant sa santé se dégrader, sa famille et ses patrons ont décidé de l’évacuer en Europe, en Suisse, pour qu’il soit soigné, et c’est là qu’on a appris qu’il souffrait du sida. Le service a été informé, le ministère a été informé, le conseil des ministres s’est réuni et a décidé, pour ne pas nuire à l’image du pays, de taire cette question du sida, d’autant qu’on n’avait pas de moyens pour lutter. On était en pleine crise économique, le budget de la santé n’atteignait pas 2%, les secteurs de l’éducation et de la santé subissaient les mesures d’ajustement structurel préconisées par les institutions de Bretton Woods. L’Etat lui-même se trouvait en panne et le sida apparaissait comme une crise supplémentaire. Le pays, dirigé d’une main de maître par Félix Houphouët-Boigny, avait connu ce qu’on appelle le « miracle économique » durant les deux décennies qui ont suivi son indépendance. Au moment du naufrage économique des années 1980, le sida arrivait. On n’avait pas de moyens, et on a décidé de ne pas en parler. On a traîné ainsi jusqu’en 1987. Il a fallu attendre février 1987 pour que le ministre de la Santé reconnaisse à la Télévision nationale la présence du sida, mais en minimisant l’épidémie, en la comparant au paludisme ou à la rougeole, qui tuaient plus que le sida. Selon lui, les occidentaux faisaient du tapage autour de ce sujet parce qu’ils avaient perdu l’habitude de mourir de ce genre de pathologie, mais les Africains ne devaient pas en avoir peur. En fait, il banalisait la question, bien évidemment, parce que l’Etat n’avait pas les moyens de faire face à la gravité de la situation. Officiellement, il ne fallait pas affoler les gens. Donc rien n’était fait. Mi 1987, les experts de l’OMS ont demandé à l’Etat de notifier les cas. Dans la vague de la création des Programmes Nationaux de Lutte contre le Sida en Afrique, l’Etat a décidé de collaborer et d’officialiser un groupe de chercheurs, un groupe de travail qui s’était formé dès 1985 après la déclaration des premiers cas au sein du service des maladies infectieuses, mais qui n’était pas reconnu officiellement, qui n’avait qu’une lettre du ministère de la Santé en guise de reconnaissance de son existence. En 1987, un arrêté ministériel a formalisé le Comité National de Lutte contre le Sida. On peut dire que c’est là le début officiel de la lutte contre le sida en Côte d’Ivoire. Pendant ces deux années, que s’est-il passé ? Le virus s’est répandu. L’enquête nationale de 1989 a révélé que la prévalence atteignait 10%. Le discours à l’époque, c’était celui des « groupes à risque », les groupes les plus touchés : les prostituées et professionnelles du sexe, les personnes ayant des maladies sexuellement transmissibles, les drogués, et dans une moindre mesure, les routiers. Ces catégories étaient déjà mises en avant par des études, mais le gouvernement ne voulait pas en parler. Il a fallu attendre décembre 1988, à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida, pour que le gouvernement décide de lâcher prise. Ceux qui étaient dans le milieu des maladies infectieuses avaient constaté cette forte prévalence. On leur donnait désormais de mallettes pédagogiques pour en parler, et les premières campagnes de sensibilisation ont vu le jour. En l’absence de traitement, l’Etat donnait son feu vert pour parler du sida, mais n’organisait pas la prise en charge. Le Programme National lui-même, élaboré en fonction des recommandations du Global Program on AIDS de l’OMS, n’avait pas pour objectif prioritaire la prise en charge, mais plutôt la sensibilisation et la sécurité transfusionnelle. Mais l’Etat n’assurait pas ce volet et faisait porter ses moyens sur la prévention. La sensibilisation a commencé véritablement en 1989, avec le fameux slogan : « Le sida est là ; il tue », et un logo funèbre placardé dans les rues pour marquer les esprits. Finalement, ça a créé quoi ? La stigmatisation des groupes qu’on avait déjà définis. Les discours portaient sur le vagabondage sexuel, le multi partenariat. Quand on lui a demandé, à la télévision, quels étaient les moyens d’éviter le sida, le ministre de la Santé a répondu : « Ayez moins de partenaires, vous n’aurez pas le sida ! ». Tout de suite, la maladie a été associée à un problème de mœurs, de multi partenariat sexuel, ce qui a marqué les esprits et favorisé la stigmatisation des malades dans les premières années.
Y compris par la création de films télévisés qui ont un certain succès populaire ?
Oui, y compris par la création de films télévisés, comme « Sida dans la cité », un film où l’on montrait que les personnes avaient le sida parce qu’elles avaient plusieurs partenaires. C’est vrai que ça sensibilisait, mais ça inscrivait aussi, dans l’inconscient populaire, qu’on attrapait le sida parce qu’on avait plusieurs partenaires. Et les signes connus, c’étaient la diarrhée et l’amaigrissement. Il y avait une série télévisée qui passait le samedi, très célèbre, qu’on appelait « Comment ça va ? ». C’était de l’humour, tout le monde aimait ça. L’une des scènes était celle d’un employé qui demandait un congé, que son employeur refusait. L’employé répondait qu’il avait la diarrhée, et l’employeur finissait par lui dire de prendre autant de congés qu’il voulait. On avait le sentiment qu’on pouvait attraper le sida par de simples contacts. Le message était celui-ci : « Méfiez-vous du sida : il tue ». Mais on ne savait pas ce que ça voulait dire, « méfiez-vous du sida ». Et même ces téléfilms de sensibilisation ont participé à la stigmatisation. Tout comme les chansons qui étaient diffusées à la télévision ivoirienne, des chansons d’artistes qui n’avaient pas été cooptés par le Comité National de Lutte contre le Sida, qui avaient décidé seuls de chanter sur le sida, mais dont les chansons étaient reprises par le Comité, qui s’en servait pour faire de la sensibilisation. En 1989, Wabi Spider, un boxer, chantait ça « Vagabondage sexuel, libertinage sexuel, divagation sexuelle, fréquentations sexuelles, le sida est là ! » C’était une maladie immorale, une maladie qui s’abattait sur les gens de basse moralité. Alpha Blondy chantait « Sida dans la cité », et le message était toujours que le sida était lié au vagabondage sexuel. Les chercheurs en sciences sociales eux-mêmes ont contribué à cela. Si vous prenez l’enquête de l’OMS de 1989 sur les comportements sexuels en Côte d’Ivoire et le sida, on le voit dans la conclusion, qui dit clairement que le sida s’est répandu en Côte d’Ivoire du fait du « vagabondage sexuel ». C’est ce message là qu’on a inculqué aux gens, et qui finalement conduisait les malades à se replier sur eux-mêmes, à ne pas se déclarer du fait de la stigmatisation. C’était une maladie sale, une maladie qui montrait qu’on n’avait pas une vie rangée, une vie correcte. Un jeune qui avait cette maladie, sa biographie était explicite pour tout le monde. A ce niveau-là, les albums, les téléfilms qu’on a faits pour sensibiliser la population, ont eu un effet pervers sur les mentalités.
Parallèlement, le volet de sécurité transfusionnelle s’est mis en place par l’installation, à l’initiative des CDC, des premiers centres épidémiologiques, RETRO-CI par exemple.
Tout à fait. RETRO-CI arrive en 1988 par un accord entre le gouvernement et les CDC américains. Pour la petite histoire, le directeur du Comité National de Lutte de l’époque m’a dit qu’il avait rencontré Kevin de Cock lors d’une conférence internationale. Kevin de Cock lui avait dit qu’ils cherchaient un endroit en Afrique de l’Ouest pour s’installer parce qu’en Afrique Centrale il y avait la guerre et qu’ils avaient un matériel important. Il a proposé la Côte d’Ivoire, en vantant ses infrastructures, et le pays a été retenu. Donc en 1988, RETRO-CI s’est installé en Côte d’Ivoire. Retrovirus Côte d’Ivoire, c’est en fait un projet qui portait exclusivement sur la recherche sur le virus du sida. La recherche a pu commencer. Ils avaient les tests, un camion, et avaient créé la clinique Confiance où ils dépistaient sur les malades suivis. Ils annonçaient les résultats dans l’optique d’une prise en charge dans cette clinique. Ce sont les femmes qui étaient les premières à être ciblées, les prostituées surtout. Mais certaines personnes à qui ils annonçaient la séropositivité ne bénéficiaient pas d’une prise en charge de leur part, et devaient se tourner vers les structures étatiques. Quoi qu’il en soit, leur camion a été connu comme annonçant les mauvaises nouvelles. En 1989, une première enquête a été menée. Avec l’accord du gouvernement, RETRO-CI a mené des recherches sur les tuberculeux dans les centres antituberculeux d’Abidjan. Mais parfois les tests étaient réalisés sans le consentement des malades. A l’époque, ces derniers venaient pour des examens de radios et de crachats et on avait ajouté des tests sanguins. Ils ne comprenaient pas pourquoi, mais on leur disait : « Faites-les quand même ! » Ensuite, pour des raisons de prévention, on annonçait les résultats à ceux qui étaient séronégatifs, on leur disait : « Vous êtes séronégatifs, mais faites attention. » Et à ceux qui étaient séropositifs, on ne faisait pas d’annonce. Finalement, de rumeur en rumeur, les gens revenaient pour dire, « Mais qu’est-ce qui se passe ? Je veux savoir ce qui a été fait de mon sang ! » Et on a commencé à annoncer à la tête du client. Les gestionnaires des CAT de l’époque disaient qu’il fallait jauger l’esprit du malade pour savoir si on pouvait lui annoncer ou non sa séropositivité : « Si on sent qu’il peut la supporter, on lui annonce sa séropositivité. » C’est partir de 1992 que les CAT annonçaient les résultats. Mais tous les examens menés avaient conduit RETRO-CI à connaître la proportion des séropositifs dans la population des tuberculeux.
Ces mêmes années, la promotion du préservatif commence à être faite par des œuvres de promotion de la planification familiale.
En fait, la promotion du préservatif est antérieure à l’arrivée du sida, qui ne fait qu’amplifier ce mouvement. Au début des années 1980, Population Service International, PSI, est arrivé en Côte d’Ivoire pour faire la promotion de la santé de la reproduction, de la santé sexuelle et de la planification familiale. Dans les conseils d’usage, il y avait l’utilisation du préservatif. PSI manquait d’arguments sur cette question parce que les Ivoiriens avaient ce discours sur les questions démographiques : « Les occidentaux se rendent bien compte que les africains commencent à peupler la terre, ils pensent qu’il faut maitriser la pression démographique, donc ils nous proposent le préservatif. Mais nous n’allons pas l’utiliser ! » Et arrive le sida, et on continue encore ! Le gouvernement a passé un accord avec l’OMS et a donné la primauté à PSI qui devait distribuer les préservatifs de marque Prudence, parce qu’il y aurait des avantages en termes de coût – le paquet de quatre préservatifs devait coûter 100 Francs, et avoir une marque unique devait revenir moins cher. PSI vendait donc la marque Prudence et s’est lancé dans sa promotion. C’est là que certaines personnes ont estimé que quelque chose ne collait pas. La promotion du préservatif, on pensait que c’était un business. D’où le slogan : « Le sida, c’est le Syndrome Imaginaire pour Décourager les Amoureux », et l’idée que le sida n’était qu’un gros montage pour vendre des préservatifs. Certains estimaient que le sida était un complot, un virus fabriqué dans des laboratoires américains pour accabler les africains. C’est dans cette vague là qu’on a commencé la promotion du préservatif, une promotion officielle. Il n’y avait pas que PSI à assurer cette promotion, mais aussi le Comité National de Lutte contre le Sida, dans ses tournées, dans ses différentes déclarations, par des T-shirts, des téléfilms comme « Sida dans la Cité » ou encore des publicités, avec comme slogan « Bien sapé, bien habillé, bien protégé ! ». Quand un médecin, au cours d’un téléfilm, devait conseiller le préservatif, c’était la marque Prudence qu’il mentionnait. Le préservatif national avait un nom : Prudence. Chose frappante, on a toujours cru que le préservatif vendu en pharmacie, c’était du luxe réservé à une certaine élite. Mais les gens ont aussi cru que le préservatif s’appelait Prudence : ils pensaient que c’était l’autre nom du préservatif, pas que c’était une marque !
C’est ainsi que PSI va lancer ce programme, soutenu par le gouvernement, en incluant des ONG, y compris à l’intérieur du pays. La lutte, c’était ça : la sensibilisation, avec des animations artistiques par moment, des animations ponctuelles, qui étaient problématiques parce qu’on attendait la journée nationale de lutte contre le sida, instaurée à partir de 1992, où quelques autres occasions ponctuelles pour faire des conférences dans des salles, dans les mairies de certaines communes. Qui recevait-on là bas ? On ne sait pas. Ou bien on organisait une grande manifestation au Plateau avec fanfare, on faisait un discours en deux ou trois minutes et on repartait. Ce n’était pas, comme on dit, des programmes d’Information/Education/Communication. Je me suis toujours posé la question : C’est quoi l’IEC ? C’est quoi la sensibilisation à laquelle on a assisté, où, de façon ponctuelle, on venait dire aux gens « Ah, le sida est là, il tue », où on accrochait des pancartes à des carrefours pour effrayer complètement les gens ? Il n’y avait pas ce corps à corps avec les communautés, dans les quartiers. Non, il n’y avait pas ce corps à corps. C’était plutôt les chercheurs qui le faisaient, à l’occasion de recherches sur les groupes cibles, par exemple sur les prostituées de tel quartier. Ils faisaient de la prévention, distribuaient des préservatifs de façon vraiment ciblée, dans quelques endroits.
Ce qui a mieux fonctionné, c’est la sécurité transfusionnelle. En 1989, l’Union Européenne a décidé de financer la restauration du Centre national de transfusion sanguine, qui était laissé pour compte, et d’ouvrir deux antennes pour pouvoir approvisionner l’arrière du pays, notamment Bouaké, Daloa, Man et Korhogo. La restauration s’est achevée en 1991. Entre ce moment et 1994, on a réduit de 99% le risque de contamination par transfusion sanguine. C’était vraiment la réussite des deux piliers retenus par l’Etat. La sensibilisation, elle, piétinait, notamment parce qu’elle stigmatisait. Le message qu’on véhiculait, c’était : « On n’a pas de remède, on n’a pas de médicament. Le sida, si vous l’attrapez, il tue, vous en mourrez. Et il est très contagieux ! ». Et donc, le malade du sida était toujours victime d’ostracisme dans sa propre maison. On estimait que manger dans la même assiette que quelqu’un pouvait apporter le sida, se laver dans la même douche, se coucher sur le même lit pouvait être source de contamination.
Comment est arrivée la délivrance des résultats des tests et les premiers modèles de prise en charge ?
Les premiers modèles de prise en charge se sont mis en place dans les années 1989/1990. C’était informel. Le service des maladies infectieuses, service de référence désigné par le Programme National de Lutte, prenait en charge les malades hospitalisés, mais c’était une prise en charge compassionnelle. RETRO-CI avait proposé de faire les tests pour l’Etat Ivoirien. Quand un malade présentait les signes cliniques dont on a parlé, ceux du score de Bangui, il était référé au service des maladies infectieuses par le médecin traitant et prélevé Le test était fait par RETRO-CI, qui assurait également l’annonce. Mais les médecins se sont rendu compte qu’il y avait l’état de séropositivité, et pas seulement l’état de sida. Le service des maladies infectieuses était débordé, il ne voyait pas comment prendre en charge les séropositifs, les malades en ambulatoire. On a donc créé l’Unité de Soins Ambulatoires et de Conseil au CHU de Treichville, juste avant PACCI, rattachée au service des maladies infectieuses, qu’on appelait l’USAC. C’était une petite unité à l’époque, composée d’un médecin, d’un conseiller, d’une assistante sociale, pour suivre en ambulatoire les séropositifs, ne serait-ce que pour donner des conseils. Et le service des maladies infectieuses va se consacrer aux malades en phase terminale, aux malades en stade sida.
Au centre antituberculeux, l’annonce va commencer à se faire dans les années 1991/1992, par le biais de RETRO-CI également. Une salle va faire office d’hôpital de jour pour suivre les malades en ambulatoire. Mais comme on avait dit aux malades tuberculeux de contacter le médecin au moindre problème, le centre antituberculeux a vite été perçu comme un hôpital de soins généralistes.
Ces quelques structures étaient chargées de la prise en charge compassionnelle du sida en Côte d’Ivoire, avec le traitement des maladies opportunistes. La dynamique de prise en charge plus globale a été lancée par les associations et par certains hôpitaux d’obédience religieuse, comme l’hôpital protestant de Dabou, le centre d’assistance médico-sociale de Treichville, qui était un hôpital évangélique, l’hôpital baptiste de Korhogo, la congrégation Sainte Camille de Bouaké, l’hôpital des Sœurs à Adzopé. A l’hôpital de Dabou, une équipe de chercheurs venus de Lyon a initié les prélèvements vers 1989. Les patients dépistés ont demandé les résultats, et certains étaient séropositifs. Ils ont dit « OK, nous on a le sida, mais on fait quoi ? » C’est ainsi que l’hôpital a décidé de créer une unité dans une annexe, où l’on recevait les gens pour discuter, pour leur parler, pour expliquer la séropositivité, dire que ce n’était pas une fatalité, que ce n’était pas la mort. Plusieurs de ces centres religieux, à Abidjan et à l’intérieur du pays, ont été les pionniers dans la prise en charge, par la mise en place de ces structures de suivi des malades. Et c’est en 1994, quand Edouard Balladur s’est rendu en Côte d’Ivoire, que les médecins du service des maladies infectieuses ont demandé une aide et que l’unité de soins a été construite comme un véritable hôpital de jour, sur le modèle européen, et financée par le gouvernement français.
La prise en charge s’est mise en place progressivement, jusqu’en 1996, par ces structures privées, financées par des bailleurs extérieurs. C’étaient des ONG qui prenaient en charge les malades du sida. La Côte d’Ivoire n’avait pas de politique véritable de prise en charge jusqu’en 1996. Dans les plans, en cinquième position, on trouvait la prise en charge. Mais la prise en charge où ? Comment ? Il n’y avait pas de séminaire pour déterminer ce qu’elle devait comprendre, pour décider des médicaments à donner en fonction des maladies. Ça ne se faisait pas. Les médecins du service des maladies infectieuses traitaient les maladies opportunistes, mais il n’y avait pas d’organisation structurée. Même à l’arrivée des ARV, il n’y avait pas de consensus national sur un programme de prise en charge médicale.
Quand les associations de lutte contre le sida ont-elles été créées ?
Il y a eu deux vagues. D’abord, la vague d’avant le sida, celle des associations nées dans les années 1960, jusqu’au années 1980, qui faisaient autre chose, qui travaillaient sur le développement, tout et rien en fait, les ONG. Avec l’avènement du sida, certaines ont incorporé la lutte contre le sida à leur activité. Puis des ONG sont créées spécifiquement pour le VIH-sida. Mais les associations de personnes vivant avec le VIH-sida, les plus connues de ces associations, ont été créées en 1994. Les deux premières ont été créées à un mois d’intervalle. Lumière Action est plus connue parce qu’elle a été favorisée, et même suscitée, par le Programme National, mais Club d’amis a été créée un mois avant. C’était un petit groupe de parole au sein du centre d’assistance médico-sociale de Treichville, un hôpital religieux, où l’on va lire la Bible, distribuer des vêtements aux séropositifs, donner de la nourriture, où ceux qui étaient chassés des maisons pouvaient rester pendant un moment. Au départ, pour le directeur de l’hôpital, l’idée n’était pas de faire une association mais de créer un groupe de soutien psychologique au sein de son hôpital. Lumière Action, de son côté, a été suscitée par le Programme National de Lutte. A la conférence de Mombasa en 1994, il a été demandé qu’il y ait des associations qui viennent d’Afrique de l’Ouest. En Afrique Centrale, en Ouganda par exemple, il y avait déjà des associations depuis 1986. En Côte d’Ivoire il n’y avait rien. Et des personnes séropositives se sont présentées au Programme, comme Etienne T., en disant « Ecoutez, je viens d’apprendre ma séropositivité, qu’est-ce que je dois faire ? » On leur a dit : « ça tombe bien, on a une conférence à Mombasa et on a besoin de trois personnes. » Et c’est au cours de cette conférence qu’ils ont rencontré des associations nées depuis fort longtemps, qui leur ont dit de ne plus avoir honte de leur situation. Et quand ils sont rentrés, ils ont monté une association qui, au départ, était un groupuscule de trois ou quatre personnes, et qui va se trouver soutenue et financée. Ils ont été soutenus dès le début par des associations comme Act Up-Paris, comme AIDES, qui leur venaient en appui, qui étaient en contact avec le PNLS. Ils avaient aussi la chance d’avoir Dominique Kérouedan, venue faire sa thèse en Côte d’Ivoire, qui travaillait sur l’intervention internationale dans la lutte contre le sida, qui avait des entrées en Europe et qui a pu les mettre en contact avec d’autres associations. Ils ont donc fait des stages, des formations. Jeanne K., qui était dans le groupe, a voyagé à travers le monde. Elle a dit que la séropositivité avait été une épreuve difficile, mais qui l’avait conduite à voyager à travers le monde. Elle a rappelé qu’elle avait bénéficié de formations, qu’on leur avait appris à revendiquer, à choisir les messages à faire passer aux autorités, à faire pression. C’était un moment important. Très vite, ces associations sont devenues dynamiques. Les gens n’avaient plus honte de témoigner à visage découvert à la télé, à témoigner au cours d’animations dans les quartiers, à dire « Nous sommes séropositifs ». 1994, c’était le tournant associatif, et ces deux associations vont être rapidement reconnues. En 1995/1996, quand il revendiquait l’accès aux ARV, le gouvernement avait déjà laissé entendre la voix des associations. Le ministère de la santé mettait en avant ces associations pour montrer que le sida, ce n’était pas que des chiffres : c’était aussi des individus, il y avait des visages du sida en Côte d’Ivoire.
Qu’est-ce qui a contribué à l’arrivée des premiers traitements, des premières bithérapies ?
Quand les associations sont nées, elles ont tout de suite revendiqué l’accès aux soins. Dominique Esmel, le premier séropositif à témoigner à visage découvert à la télévision ivoirienne en juillet 1993, avait l’opportunité de bénéficier d’antirétroviraux, parce que certains groupuscules étaient favorisés. Mais il avait dit qu’il ne prendrait pas d’ARV tant qu’ils ne seraient pas disponibles pour tous. Et il est décédé en 1996, le 30 novembre, à la veille de la célébration du premier décembre. Ça a choqué tout le monde, parce qu’il avait préparé un discours, qui a été lu par Jeanne, dont je parlais. Ce jour-là, ses collègues ont dit qu’ils pensaient abandonner : « Si les gens continuent de mourir, nous abandonnons la lutte. Si l’accès aux soins n’est pas possible, nous abandonnons ». Les autorités elles-mêmes ont senti qu’il y avait une pression. Or, elles n’avaient rien de concret à proposer. Elles faisaient de la sensibilisation, mais, finalement, qui était assimilée à du folklore. On faisait de la sensibilisation, mais les malades n’avaient toujours rien.
La Côte d’Ivoire devait organiser en 1997 la 10ème CISMA, qui allait être un grand moment, après celle de Kampala en 1995. C’était jusque-là des conférences où il n’y avait que des médecins, qui venaient parler de virologie, de choses auxquelles les gens ne comprenaient rien. Mais en 1997, on a décidé de changer de thème et les organisateurs ont voulu que la Côte d’Ivoire fasse ressortir le côté social de l’épidémie. On a donc parlé de santé et de développement. Le professeur Auguste Dieudonné Kadio, qui pilotait cela, a expliqué qu’il avait retenu ce thème après avoir discuté à Kampala avec de jeunes africains, qui lui avaient dit « Pourquoi est-ce qu’on vient nous parler seulement de questions de virus et de recherche ? Il faut aussi parler de l’impact social du sida ! » Au départ, le thème retenu était « Les conséquences socio-économiques du sida », mais ça faisait long, « Sida et développement » a donc été préféré. Pour la première fois, ce thème-là a été abordé. La même année, une session de la conférence internationale sur le sida de Vancouver portait aussi sur cette thématique. Elle était présidée par le ministre de la Santé de Côte d’Ivoire. Quand il a pris la parole à la tribune, il s’est exprimé ainsi « Nous ne pouvons pas rester insensibles aux bruits qui nous parviennent de partout sur les thérapies antirétrovirales. Aidez-nous à nous soigner, sinon, vous ne trouverez personne pour rembourser les prêts que vous nous faites. »
En 1997, l’ONUSIDA a décidé de lancer un projet pilote d’accès aux antirétroviraux et a choisi quatre pays dans le monde. En Afrique, la Côte d’Ivoire et l’Ouganda ont été retenus. Les autres pays retenus étaient le Chili et le Viêt-Nam. Quand Peter Piot a pris la tête de l’ONUSIDA, en 1995, sa première visite a été en Côte d’Ivoire. Il avait souligné que c’était un pays qui communiquait sur le taux de prévalence et qu’il méritait, à ce titre, d’être reconnu, d’être récompensé. La Côte d’Ivoire a donc été choisie non seulement parce que c’était le pays le plus touché d’Afrique de l’Ouest, mais aussi parce que les chiffres étaient communiqués. On était à 25 000 séropositifs en 1995, et c’était dit ouvertement. La fondation Fonsida, installée au Centre de transfusion sanguine, importait déjà de petites quantités d’ARV, réservés à une certaine élite. C’était le début de la prise en charge en Côte d’Ivoire. Il y avait aussi des infrastructures de recherche, comme le service des maladies infectieuses, qui était reconnu pour sa compétence ; des infrastructures qui faisaient qu’on pouvait commencer la prescription d’antirétroviraux.
Il y avait également des projets de recherche comme DITRAM, avec cotrimoxazole contre placebo ?
Tout à fait. Depuis 1994 des projets de recherche se mettaient en place. Le projet DITRAM, c’était le projet de diminution de la transmission mère-enfant mis en place au sein du service des maladies infectieuses, qui testait le cotrimoxazole contre placebo. En l’absence d’ARV, il fallait voir si ce médicament pouvait aider les malades. L’essai a démontré qu’un comprimé de cotrimoxazole par jour améliorait la santé du malade en l’absence d’ARV. Il y a eu quatre essais à cette époque, sur plusieurs sites. Tout était bien mené, les malades les suivaient bien, les praticiens également, et ne semblaient pas effrayés par la conduite de ces projets. Il y avait RETRO-CI, mais aussi l’institut Pasteur. Déjà bien d’autres centres étaient en place et participaient à ces essais. Il y avait un centre français au CHU de Treichville, le CeDRES, qui faisait des recherches sur les maladies opportunistes, ce qui permettait de savoir quelles étaient les maladies opportunistes qui circulaient en Côte d’Ivoire. Oui, la recherche était assez dynamique. Tous ces aspects ont participé au choix du pays.
La 10ème CISMA a été un tournant décisif. On y a levé des tabous. C’était une grande fête. Plus de 2 000 participants étaient attendus ; il y a eu plus de 250 communications, et près de 200 associations. Il y avait un forum des associations à Bassam, dans lequel les associations étaient réunies depuis six mois et travaillaient sur un programme d’action. Ce forum, c’était l’attraction en Côte d’Ivoire ! L’Etat, au plus haut sommet, s’était engagé. Le président Jacques Chirac a été invité ; il est venu avec Bernard Kouchner et Marc Gentillini. Au cours de son allocution, il a dit qu’il ne fallait plus qu’il y ait deux manières de lutter contre le sida, avec les médicaments au Nord et la sensibilisation au Sud, et qu’il était important de donner des médicaments au Sud. Il a parlé du « sida à deux vitesses », affirmant qu’on ne pouvait plus, dans les milieux internationaux, parler des droits de l’Homme, et à l’abri des meilleures raisons qui soient, limiter l’accès aux ARV. Il a lancé l’idée de la création d’un fonds de solidarité thérapeutique international, qui a été mis en place par la suite. Le président Henri Konan Bédié a également pris la parole. Il a lancé l’idée d’un fonds national de solidarité pour l’achat des ARV. On voyait très bien que le nouveau paradigme de la lutte, c’était la prise en charge par antirétroviraux. L’initiative ONUSIDA a démarré en août 1998, et a boosté la prise en charge.
Avec une particularité, la distinction entre centres accrédités et centres de suivi ?
Oui, il s’agissait d’un projet pilote. Ce n’était pas un essai ; pour tout le monde, c’était la fin des essais. Huit sites avaient été accrédités par l’ONUSIDA, dans lesquels on aurait des antirétroviraux. Dans les huit autres sites de suivi, on avait seulement accès aux traitements des maladies opportunistes. C’était un accès aux traitements du sida, pas un accès aux traitements antirétroviraux ! Les débuts ont été difficiles. Le prix initial des thérapies était de 600 000 francs CFA par mois. Après négociations de haut niveau, les firmes pharmaceutiques ont baissé le prix à 100 000 ou 80 000 francs par mois. Concrètement, c’était difficile pour l’ivoirien lambda. 80 000 francs, ça restait encore inaccessible, même pour les fonctionnaires, qui, sur un salaire de 250 000 francs, ne pouvaient pas prélever 50 à 100 000 francs pour les traitements, sans compter les autres frais. Le gouvernement ivoirien a donc doté un fonds de 600 millions de francs CFA pour subventionner les ARV, une fois leur coût diminué par les firmes pharmaceutiques. 250 femmes, celles du projet DITRAM, avaient déjà commencé à prendre des ARV. Elles étaient incluses de fait dans l’initiative ONUSIDA. Il fallait par ailleurs ménager les associations de personnes vivant avec le VIH-sida. On a donc retenu les associations, les femmes de DITRAM ainsi qu’un certain nombre d’autres personnes qui étaient dans les essais cliniques. Les coûts étaient réduits à 5 000 francs ou 10 000 francs ; 5 000 francs pour la bithérapie, 10 000 francs pour la trithérapie.
Mais cela a créé une course vers les associations, parce que les gens qui voulaient se faire traiter n’avaient pas les moyens de payer 100 000 francs. Or les associations avaient droit à des listes qu’elles pouvaient soumettre au comité chargé de piloter l’initiative. Ce comité a rapidement estimé que la cagnotte de 600 millions de francs ne pouvait pas suffire, parce que les associations venaient avec des listes interminables. Et d’autres associations sont venues dans la foulée. De deux, on est passé à sept associations de séropositifs. Le gouvernement ne pouvait pas supporter les coûts que générait cette course là, et l’idée était d’aller vers les génériques. Par ailleurs, le gouvernement était en crise. 1998, c’est la rupture des relations entre la Côte d’Ivoire et les institutions de Bretton Woods, sur des questions de détournement de fonds (la fameuse affaire des 18 milliards de l’Union Européenne, qui avaient été accordés pour le développement de la santé et qui se sont volatilisés). Il y a eu des sanctions dans le domaine de la santé, et une certaine frustration. L’initiative ONUSIDA, qui devait toucher 4 000 personnes, a démarré avec des chiffres dérisoires. Il a fallu attendre 2000 pour atteindre 2 000 personnes. On traînait avec 100 personnes, 500 personnes. Il a fallu attendre plus de deux ans pour traiter 2 000 personnes, et on n’a jamais atteint le chiffre de 4 000 personnes. Le bilan de cette initiative a été présenté en 2000, à la conférence de Durban. Il a montré que la Côte d’Ivoire avait le meilleur bilan parmi les pays retenus. Dans le même temps, le gouvernement a décidé de superviser la question des antirétroviraux pour faciliter leur accès grâce aux génériques. C’était un moment de conflit. Les médecins des centres accrédités ne voulaient pas prescrire des génériques, parce qu’ils n’avaient pas confiance, les laboratoires qui les fabriquaient n’étant pas pré-qualifiés par l’OMS. Il y a eu toute une bagarre autour de ce sujet.
Le gouvernement commandait des génériques, qui n’étaient pas prescrits, et les médicaments de spécialité faisaient défaut, parce qu’ils n’avaient pas été commandés. Finalement les malades manquaient de traitements. Du jour au lendemain, leur médecin prescripteur leur disait d’aller négocier avec le Programme National, parce qu’ils ne voulaient pas leur prescrire des génériques. La bagarre a eu lieu dans les deux directions. Certaines associations se sont retournées contre le Programme National en disant « On nous a dit qu’on voulait nous donner n’importe quoi ! On vous donne de l’argent que vous gardez par devers vous ! » Mais d’autres avaient un autre discours : « Même si c’est par des génériques, traitez-nous ! Vous nous avez dit de ne pas arrêter les traitements, mais c’est vous qui suspendez les prescriptions ! » Le chef du service des maladies infectieuses a été séquestré par des séropositifs qui menaçaient de lui injecter le virus avec des seringues. Il y a eu cette crise des années 2000. Et après, une attente. Lors de la conférence de Durban, un parterre de médecins ivoiriens était invité, tous frais payés par les firmes pharmaceutiques, ce qui a fait beaucoup de bruit. Si les firmes invitaient les médecins qui s’opposaient à la prescription des génériques, c’est qu’il y avait anguille sous roche ! Cela va créer tout un débat sur la pression des firmes pharmaceutiques sur les médecins traitant. Quand la pré-qualification des traitements est intervenue, un consensus a été trouvé sur la prescription des génériques. Et quand il a été admis qu’on allait prescrire des génériques, on est aussi passé à la prise en charge dans le privé, qui était prônée depuis des années.
En 2000/2001, c’est l’arrivée du PEPFAR, qui va injecter d’énormes fonds. Le Fonds Mondial arrive également. Son premier round, c’est en 2002, avec la création du CCM, Country Coordinating Mechanism, dirigé par le chef de service des maladies infectieuses de l’époque. Le programme national de lutte contre le sida est devenu un ministère. On avait un ministère auprès du premier ministre, chargé de la lutte contre le sida, et un Programme National de prise en charge des personnes vivant avec le VIH au sein du ministère de la santé, chargé de gérer la politique de prise en charge médicale. Les tests de dépistage se déployaient. La Prévention de la Transmission Mère-Enfant était devenue un objectif central de la lutte. Et pour qu’il y ait PTME, il fallait qu’il y ait dépistage. Des centres de dépistage ont été créés dans chaque hôpital, à l’intérieur du pays. La PTME s’est mise en place et la prise en charge a commencé à être intégrée dans différentes structures, d’où ce qu’on a appelé la politique de prise en charge intégrée.
La crise de 2002 arrive et divise le pays. Cette division concerne-t-elle aussi la prise en charge ?
Oui, la crise de 2002 est terrible parce qu’elle a divisé le pays. La situation n’était pas celle de 2010, où il pouvait avoir un début de réconciliation. En 2002, la prise en charge intégrée était assurée dans les structures du Sud du pays. Mais de l’autre côté, il n’y avait pratiquement rien, parce que l’Etat n’avait pas accès aux régions du Nord, et que la prise en charge n’était pas une priorité pour la rébellion. Les fonctionnaires n’allaient pas dans ces régions, ils se retrouvaient tous au Sud. C’étaient des ONG, des humanitaires qui tenaient les centres de santé au Nord, et qui faisaient ce qu’ils pouvaient. Ce n’était pas une véritable politique d’Etat qui était mise en place, et la prise en charge ne se déployait pas comme prévu. En 2004, il y a eu un débat sur ces questions, quand le ministre a déclaré que le taux national de prévalence était de 7% alors qu’on était autour de 10% dans les années 2000/2001. Les gens disaient : « Mais d’où sort ce chiffre? Est-ce que vous avez fait les tests au Nord ? On ne sait pas ce qui s’y passe. » Ce débat montrait bien qu’on n’avait pas idée de ce qui se passait dans cette partie du pays. La prise en charge ne pouvait pas se faire de façon correcte et les gens du Nord étaient laissés pour compte du fait de la crise. C’est dans les régions du Sud que la prise en charge s’était développée. Et on s’est rendu compte qu’il y avait eu une redistribution du virus. Dans les débuts, c’était les régions du Sud et de l’Est qui étaient le plus frappées par l’épidémie. Mais on s’est rendu compte après la crise qu’il n’y avait pas de différence entre les régions du pays. On parlait de 4% à Abidjan. Le Nord-Ouest, qui était une région faiblement touchée, se retrouvait aussi à 4% de prévalence. La prévalence nationale se situait entre 3 et 4%. Ce n’était plus 5% au Sud et 2% au Nord, mais ça se tenait. Et puis, il y avait une féminisation de l’épidémie. Au début de l’épidémie, quatre hommes pour une femme étaient touchés. Dans les années 2000, ça tendait à s’équilibrer, puis on est passé à un taux de prévalence qui gravitait autour de 3%, avec un taux de 6% chez les femmes et de 2% chez les hommes. Cette tendance s’explique par les effets de la crise.
La crise, c’est d’abord une crise militaire qui va créer des déplacements massifs de population. A une époque, le terme déplacé de guerre s’est imposé. Il y avait les « DG » et les « PDG », les « déplacés de guerre » et les « premiers déplacés de guerre ». On avait tourné la situation en dérision. Les premiers déplacés de guerre étaient les gens de Bouaké qui étaient arrivés à Abidjan. La rébellion occupait 60% du territoire, mais la région gérée par le gouvernement abritait plus de 60% de la population. Il y avait certes des quartiers précaires à Abidjan, mais ce n’était pas aussi formel que ce n’est devenu. Les quartiers précaires sont devenus des quartiers à part entière. Ceux qui arrivaient à Abidjan venaient en famille. Ma famille a été déplacée à partir de 2002 et s’est retrouvée chez le mari de notre grande sœur, qui du jour au lendemain est passé de cinq personnes à charge à près de seize personnes, dans une maison de quatre pièces. Les gens dormaient pratiquement dans la cour arrière, sous une sorte de hangar. Et c’était comme ça dans tous les foyers. Du coup, les familles déplacées vivaient dans la précarité, mais les familles d’accueil elles-mêmes se retrouvaient dans la précarité. Le train de vie baissait, et des techniques de survie se mettaient en place : la prostitution informelle, mais également le banditisme, les agressions, la consommation de drogues. Les fléaux sociaux s’amplifiaient, parce que la vie elle-même se détériorait, la médiocrité devenait une formation qualifiante. Pourvu qu’il y ait quelque chose à faire, on le faisait. Ça a renforcé quoi ? La corruption, le népotisme. Tout ce mal prenait de l’ampleur ; on faisait ce qu’on pouvait pour vivre. L’arnaque, ce qu’on appelle le phénomène de broutage, qui est l’arnaque sur internet, si répandue en Côte d’Ivoire, est un phénomène qui a démarré en 2002, de même que le coupé-décalé. Dans le jargon ivoirien, c’est l’arnaque : couper quelqu’un et décaler, c’est le voler. La crise de la moralité va commencer à prendre de l’ampleur. Les émigrés revenaient de France, en pleine crise, avec des vêtements de marque, des belles voitures. On ne savait pas ce qu’ils faisaient. Ils disaient avoir des entreprises en Europe, qu’ils faisaient du business. Personne ne savait vraiment, mais ils étaient adulés. Et les Ivoiriens venaient noyer leur chagrin dans les grands maquis, dans les grands boîtes. A partir de 2000, de nouveaux pôles de distraction se sont mis en place avec ces grands maquis qui pouvaient regrouper jusqu’à 500 personnes. Chacun montrait, en pleine crise, sa puissance financière. Et cela, cette volonté d’exister, a donné lieu à un réseau de prostitution. C’était aussi une crise de moralité. On ne sait pas ce que les gens faisaient pour avoir de l’argent. En fait, c’était l’arnaque, et les jeunes ont commencé à s’y mettre, en se disant qu’ils pouvaient soutirer de l’argent aux blancs, en leur proposant des mariages fictifs, en leur vendant toute sorte de choses. Les idoles des quartiers, c’étaient ces jeunes qui ne faisaient rien, mais qui, du jour au lendemain, trouvaient beaucoup d’argent.
Mais sur cette génération, la question du VIH, celle du préservatif, n’ont plus aucun impact ?
C’est l’effet pervers de ce phénomène. Un DJ très célèbre a dû s’expliquer sur l’une de ses chansons où il parlait du « sans guêbê », c’est-à-dire des rapports sans préservatifs. Il a dû dire que c’était pour que les gens utilisent le préservatif. Le promoteur du coupé-décalé est lui-même décédé en 2006, à 32 ans. C’était un jeune qu’on surnommait Douk Saga, « le sommet de l’Himalaya ». Il est décédé au Burkina Faso. On disait qu’il avait un mal pernicieux qui l’a rongé pendant des mois, on parlait de tuberculose, on parlait de ceci ou de cela. Finalement, on n’a jamais su ce que c’était. En 1989, Fulgence Kassy est mort, et on soupçonne qu’il est mort du sida. C’était une célébrité. Douk Saga était la deuxième personnalité qui a eu des funérailles de grande envergure. Quand son cercueil est arrivé à l’aéroport d’Abidjan, il y avait un monde fou, tout un cortège, tout le monde était en blanc. C’était comme pour les éléphants de Côte d’Ivoire, de retour avec la coupe d’Afrique. Quand on a annoncé sa mort, les gens pleuraient dans les foyers. On l’appelait « le Héros national ». Il disait que tout le monde avait souffert pendant la guerre, mais qu’il était venu apporter la joie dans les foyers.
Mais pendant ce moment se posait la question du préservatif. Il y avait des sensibilisations, de temps à autre, mais ce n’était pas vraiment perceptible. L’argent était incriminé : on avait l’impression que le sida était devenu une affaire d’argent contre la rébellion. Des rebelles se laissaient aller à des exactions. Une jeune fille séropositive avait été violée par des chefs rebelles. Elle a témoigné à la télévision que l’un de ses violeurs était ministre. Des enquêtes ont montré que des chaînes de prostitution étaient mises en place et favorisaient la propagation du VIH. Sur le terrain, les gens constataient que le sida prenait de l’ampleur, parce qu’il n’y avait pas de sensibilisation là-bas, mais aussi parce que l’usage de drogues augmentait. Au Nord, il n’y avait pas d’administration pour gérer ces questions. Donc, dans l’entendement des gens qui vivaient au Sud, le sida était désormais une question des gens qui vivaient sous le contrôle de la rébellion. Et au Sud, le gouvernement mettait les bouchées doubles sur le plan de la prise en charge. Le Comité National de Lutte était dirigé par le président de la République, mais en même temps, au niveau du quotidien, de la question du préservatif, les dispositions étaient prises par les personnes qui prenaient conscience elles-mêmes de la situation : le matraquage médiatique, ce n’était plus trop ça.
Et quel était le rapport des personnes vivant avec le VIH au système de prise en charge intégrée ? Est-ce qu’il a finalement facilité l’accès aux soins ?
Oui, les chiffres sont en hausse depuis des années donc, en termes de résultats, ça a apporté quelque chose. Mais cette politique est problématique parce que la prise en charge intégrée a été décidée pour décentraliser. Qu’entend-on par décentraliser ? Cela veut dire que dans chaque centre de santé, on assure le dépistage, la PTME, la prise en charge. Mais en même temps, on retrouve des malades qui viennent des endroits où ils ont été dépistés pour se faire soigner dans un autre quartier, dans l’anonymat. Le bilan est mitigé parce qu’on a intégré les soins du VIH, mais comment ? Chacun décide, au sein de son hôpital, d’intégrer les soins du VIH de la manière qu’il souhaite. Le gouvernement mène une politique de prise en charge intégrée et chaque centre définit ce qu’il entend par intégration. Alors, quelle est la situation ? Il y a des centres de santé où on a créé un bâtiment spécial dédié aux personnes vivant avec le VIH. Toutes les autres pathologies sont donc traitées dans d’autres bâtiments. Et cela pose problème. Les responsables disent que les bâtiments sont assez discrets, qu’il y a des couloirs. Mais la personne qu’on voit sortir d’un couloir menant à un service de prise en charge du VIH, on peut s’imaginer facilement qu’elle est séropositive. Il y a eu plein de rumeurs sur des gens qui ont été identifiés comme séropositifs, alors qu’ils étaient peut-être venus rendre visite à un proche. Il y a la deuxième situation où les patients sont pris en charge par les mêmes médecins, mais où l’on réserve un jour de consultation aux personnes vivant avec le VIH. Et donc ça créé la même situation. Il y a enfin des centres où la prise en charge du VIH est complètement intégrée, où l’on reçoit tout le monde sur le même banc et où personne ne sait qui vient pour le VIH. Mais la prise en charge du VIH hérite des mêmes faiblesses que le système de santé. C’est-à-dire que le médecin qui reçoit soixante personnes par jour n’a pas le temps de discuter avec tout le monde, il renouvelle juste les ordonnance, il n’a pas le temps de savoir ce que les gens vivent, ce qui se passe. Quand on lui parle de telle pathologie, il dit, « Non, on verra ça la prochaine fois ! » Les perdus de vue ne sont pas recherchés. Quand un malade s’absente pour deux ou trois consultations, le médecin ne cherche pas à savoir pourquoi, parce qu’il a trop à faire. Il quitte son travail à 15h/16h, complètement crevé. Il n’y a pas d’assistants sociaux dans ces centres de prise en charge intégrée. A la limite, on en trouve un, qui a 2 000 malades à suivre. Je suis allé dans un centre pour une enquête. Il y avait deux postes de médecins, dont l’un était vacant. Le médecin avait une file active de 2 000 malades, soit près de soixante consultations par jour. Il disait être en mesure de discuter avec les premiers malades de la journée, mais qu’au bout du vingtième, il n’y arrivait plus. Au niveau national, il a des centaines de milliers de malades à suivre. La politique de santé estime qu’ils ne peuvent pas tous être suivis dans des centres spécialisés. Mais à l’intérieur du pays, la spécialisation a créé des problèmes : les gens n’ont pas voulu aller dans les premiers centres spécialisés parce qu’ils s’y sont sentis stigmatisés.
Quelles ont été les relations avec les tradipraticiens ? Y-a-t-il eu un travail commun ?
Il y a un programme national sur les tradipraticiens au sein du ministère de la Santé, mais dans les faits, on peut dire que cela a mal commencé dès le départ. Il n’y a pas de dialogue entre la médecine moderne et les tradipraticens parce que qu’il y a une constante défiance. Les médecins estiment que ce sont eux qui ont fait les études, qui maîtrisent la médecine, qui savent comment soigner les gens et que le charlatanisme, ce n’est pas leur tasse de thé. Au début de la lutte contre le sida, les tradipraticiens se disaient capables de guérir le virus du sida et le gouvernement a tenté une collaboration qui a tourné court, parce que les médecins ne voulaient pas entendre ce langage. Ce qui a fait que, pendant longtemps, les tradipraticiens sont restés dans l’ombre. Mais en réalité, ils estimaient qu’ils pouvaient guérir le sida et que la biomédecine, sous l’emprise des firmes pharmaceutiques, des grands laboratoires, n’avait aucun intérêt à guérir le sida parce que, comme ils disaient, les médecins vivaient de cette maladie, le sida était devenu un business, un marché. Et ce discours était entendu par la population, d’autant que dans la culture populaire, le terme de maladie incurable n’existe pas. Une maladie a un remède et les gens ont toujours l’espoir que le tradipraticien va le trouver. Dans les années 1990, Drobo II a été assassiné. C’était l’homme qui disait guérir le sida au Ghana. Toute a été dit. Que c’était un complot. Et les tradipraticiens sont entrés dans une sorte de clandestinité et ont surfé sur ça : « Ecoutez, nous, on soigne mais on ne va pas le dire parce qu’ils vont nous assassiner, vous avez vu Drogbo II ! ». Pendant longtemps, les tradipraticiens sont restés dans ce discours et il n’y a pas eu de collaboration du gouvernement. De manière officielle, on va dire « Oui, le ministère fait beaucoup, on essaie d’avoir une collaboration. » Mais quand on demande concrètement « A quel niveau de collaboration êtes-vous ? », la réponse est « Pour le moment, nous sommes en train de voir comment on va faire, on essaie déjà de répertorier les tradipraticiens …» Rien n’est dit de concret. Or plus d’un malade sur deux va voir les tradipraticiens. C’est connu ! Les malades fréquentent la médecine moderne, prennent leurs ARV et fréquentent aussi les tradipraticiens. Au début, ils étaient dans la défiance. Mais maintenant, ils tiennent un discours du genre « Vous pouvez prendre vos ARV, mais nous, on a un médicament qui n’a pas d’effet secondaire, un médicament naturel, fait à base de plantes… »
Finalement, pensez-vous que les mentalités ont évolué ?
On a balayé une histoire assez large ! En résumé, en suivant la mise en place des instruments de lutte contre le sida en Côte d’Ivoire, on perçoit l’évolution de la prise de conscience du problème par les autorités. On se rend compte que les choses bougent à partir de 1987. Mais concrètement, on n’a rien fait entre 1985 et le milieu des années 1990. Heureusement qu’il y a eu la sécurité transfusionnelle. On a fait un peu de sensibilisation, mais il n’y a rien eu d’autre. Ce qui fait que ce n’est que récemment que les choses bougent. Les mentalités sont difficiles à changer parce que jusqu’en 2000, le sida est resté une maladie immorale, une maladie stigmatisante, la maladie des gens qui ont des mœurs légères, des prostituées. Depuis 2008, les ARV sont gratuits. Les malades vivent plus longtemps. Je connais des malades qui ont été dépistés en 1998, qui sont en forme ! On ne peut pas imaginer qu’ils ont le VIH ! Les Ivoiriens se rendent compte qu’ils côtoient des séropositifs, ils commencent à voir le VIH. C’est-à-dire qu’au début, le sida n’avait pas de visage. De plus en plus, les gens ont quelqu’un dans l’entourage qui est séropositif, qui vit bien, avec une bonne hygiène de vie, qui partage avec tout le monde. On se rend compte qu’on n’a pas à stigmatiser la personne. Les Ivoiriens ont commencé à s’habituer, ont commencé à voir les séropositifs. Et il y a d’autres grands tueurs, le diabète, l’hypertension, avec leurs cohortes de morts. Finalement, l’idée de pathologie chronique est en train de rentrer dans la tête des gens. Grâce à la PTME également, parce que le dépistage est quasi systématique maintenant en consultation prénatale, et cela pousse chacun à faire le test. C’est ce qui a permis à la Côte d’Ivoire de prendre conscience du sida. Il faut aussi rappeler que les associations de séropositifs ont fait beaucoup dans l’histoire de la lutte. Elles ont été très dynamiques, elles ont vraiment boosté les choses. Elles ont poussé le gouvernement à prendre les choses en main. Il faut saluer ce rôle des associations qui ont des membres qui ne se cachent plus, qui vont ouvertement à la télé. Il y a eu des émissions consacrées à la lutte contre le sida, au témoignage, dans lesquelles les gens venaient parler de l’histoire de leur vie et sensibiliser. Tout cela a contribué à faire prendre conscience aux Ivoiriens de la réalité du sida.
Merci.
 « Cette épidémie a frappé de
plein fouet la Côte d’Ivoire… »
« Cette épidémie a frappé de
plein fouet la Côte d’Ivoire… »