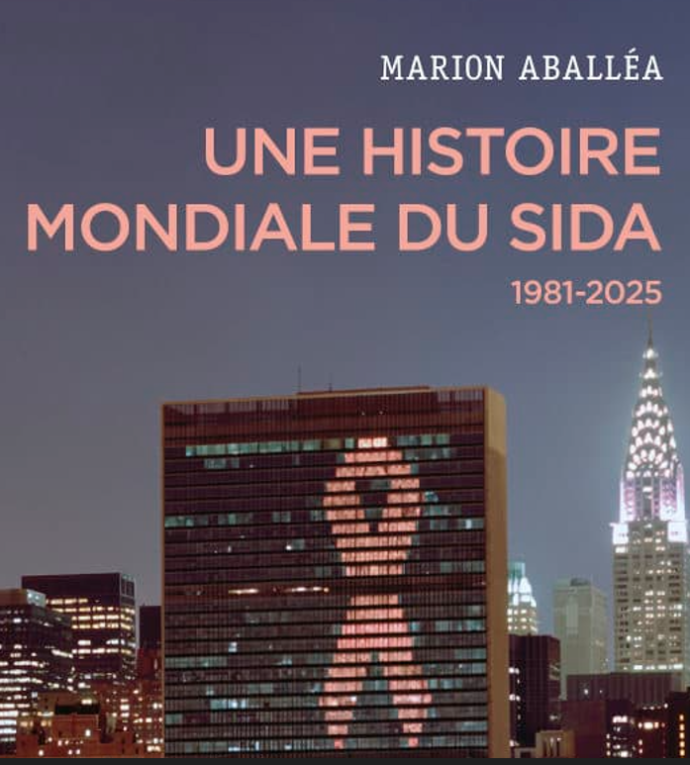L’Agence Nationale de Recherche sur le Sida (ANRS) a publié en juillet 2020 un document de synthèse sur l’épidémie à VIH en France, Tendances et contribution de la prévention combinée (dépistage, traitement antirétroviral des PVVIH, prévention par le préservatif et la PrEP). La présidente de l’Action coordonnée 47, Dynamique et contrôle des épidémies VIH et hépatites, Dominique Costagliola nous commente ce rapport.
Transversal : Quel est l’objectif de ce travail de synthèse ?
Dominique Costagliola : Notre objectif était de compiler l’ensemble des données disponibles, celles issues de la déclaration obligatoire de séropositivité et des estimations d’incidence réalisées à partir de ces données, mais aussi les données relatives à l’usage de la PrEP et du préservatif, au dépistage et à l’effet préventif du traitement des personnes vivant avec le VIH. Nous souhaitions porter un regard sur de l’ensemble des approches de prévention pour essayer d’en tirer des conclusions sur les pistes d’action à mener.
T. : Peut-on dire que les dynamiques de l’incidence du VIH et des découvertes de séropositivité se suivent ?
D.C. : Cela dépend des groupes. C’est plutôt le cas pour les populations nées en France, mais des difficultés persistent pour les populations nées à l’étranger. La situation de ces personnes reste difficile à bien cerner parce que la taille des populations migrantes est mal connue. Mais on conserve l’impression qu’une partie de la situation de ces populations s’explique par une augmentation des migrations sur une période récente, pas seulement de ressortissants de pays d’Afrique subsaharienne mais aussi de personnes venant de pays du Moyen-Orient par exemple. Il est par ailleurs toujours difficile de savoir si les personnes migrantes étaient déjà contaminées lorsqu’elles sont parties de leur pays, si elles ont été contaminées pendant la migration ou encore depuis leur arrivée. Pour ces populations, il faudrait vraiment développer des actions auprès des structures qui les accueillent afin que dépistage et prévention du VIH et d’autres maladies transmissibles soient assurés.
T. : Voit-on des épidémies émerger dans des populations qui n’étaient pas très représentées jusque là ?
D.C. : Ce qui est assez différent, c’est que l’on voit, y compris pour des populations de pays d’Afrique subsaharienne, des origines différentes mais surtout des parcours très à risque. A l’heure actuelle, les chemins de la migration, en particulier pour les parcours « non documentés », comme on peut le dire en anglais, sont très longs et difficiles et comportent des risques de contamination sexuelle lors de rapports non consentis. C’est quelque chose sur lequel les données manquent encore mais qui mérite d’être exploré. L’autre élément qui émerge est relatif aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Jusque là, Santé publique France n’avait pas établi de distinction dans ce groupe selon l’origine géographique. C’est une nouveauté des présentations récentes : on constate que la situation des HSH migrants n’est pas du tout la même que celle des HSH nés en France. Là aussi, cela ça veut dire qu’il faut mener des actions ciblées en direction de cette population. Il s’y trouve des personnes d’origines que l’on constatait peu auparavant. Mais une part de l’augmentation des découvertes de séropositivité dans ces populations vient peut-être du fait que l’homosexualité est rendue plus dicible.
T. : On a l’impression qu’il reste difficile de réduire la part des personnes qui découvrent tardivement leur séropositivité. Est-ce le cas ?
D.C. : Travailler avec les structures qui accueillent ces personnes devrait tout de même permettre de mieux cerner la façon d’organiser, pour elles, le dépistage. Mais quand on voit ce qui a pu être fait dans les « Villes sans sida » [i], il semble difficile d’aller beaucoup plus loin dans le dépistage. On voit bien par exemple qu’avec le programme « Au Labo sans ordo » [ii] on peut gagner un peu en nombre de tests réalisés, mais pas de manière extraordinaire. Comme toujours en matière de prévention, ce n’est pas une seule mesure qu’il faut promouvoir mais un ensemble de mesures qu’il faut activer en même temps. Evidemment, la prise en charge tardive persiste, elle est toujours aux alentours de 25%. Mais on ne voit pas bien ce qui pourrait être proposé de vraiment nouveau, à part pour les populations migrantes, pour améliorer de manière significative la situation. En effet, à peu près tout ce qu’il était possible d’imaginer a été mis en œuvre, en particulier dans les « Villes sans sida ».
T. : Mais a-t-on vraiment cherché à caractériser ces situations de dépistage tardif ?
D.C. : Les facteurs associés à la prise en charge tardive évoluent peu. Au sujet des populations HSH d’origine étrangère, le projet Ganymède [iii], mené par Romain Palich, de la Pitié Salpêtrière, doit permettre de mieux comprendre les parcours de ces personnes, ce qui devrait apporter un éclairage utile sur cette population. On voit d’autres microprojets arriver également, sur des populations de petite taille, sur lequel il serait possible d’avoir plus de connaissances. Mais quantitativement – bien sûr, cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas le faire – ça ne va pas changer la donne au niveau national.
T. : Concernant l’efficacité préventive du traitement, a-t-on atteint un niveau optimal ?
D.C. : Oui, là aussi, il paraît difficile d’aller beaucoup plus loin. Les taux de patients traités sont très élevés dans toutes les régions choisies pour illustrer notre rapport. Pour les personnes nouvellement prises en charge, le délai de mise sous traitement est vraiment court. Il reste bien sûr des gens qui n’arrivent pas dans le soin, mais malgré tout en petit nombre. Les personnes jamais traitées ne représentent qu’un pour cent, ce qui est vraiment limité. La proportion de gens traités dont la charge virale est indétectable est de 97%. Globalement, plus de 90% des personnes vivant avec le VIH et prises en charge ont une charge virale inférieure à 50 copies/ml de sang. Si l’on considère le seuil du risque de transmission, c’est-à-dire une charge virale inférieure à 200 copies, c’est la situation de plus de 95% des personnes vivant avec le VIH. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas des groupes pris en charge plus tardivement, mais ces situations se retrouvent quand même très majoritairement chez les personnes non diagnostiquées.
T. : Concernant la PrEP, on voit son effet principalement chez les HSH. Se dirige-t-on vers une extension de son usage au sein d’autres populations ?
D.C. : Cette extension reste marginale. 97% des utilisateurs sont des hommes aujourd’hui encore. L’une des choses vraiment importante serait de revoir les recommandations. Elles ont été rédigées il y a plusieurs années sur la base de résultats d’essais. Maintenant, des données montrent que la PrEP fonctionne bien même en dehors des essais et qu’il n’y a pas d’inquiétude à avoir en termes de sécurité. Il faut donc revoir ces recommandations pour que la prescription de PrEP ne soit pas restreinte comme elle l’est aujourd’hui aux personnes les plus à risque. Cela ne sera pas suffisant, il faudra penser aussi à la façon dont la dispensation est organisée, mais c’est un premier pas nécessaire.
T. : Est-ce vraiment au niveau des recommandations qu’il faut agir ? Les populations migrantes ne sont pas exclues des recommandations aujourd’hui…
D.C. : Les recommandations sont quand même très ciblées sur les personnes les plus à risque et principalement sur les HSH. Je pense que le fait que la PrEP puisse être largement prescrite en dehors de cette population n’est pas quelque chose de communément admis et encore moins de mis en œuvre. Bien sûr que, dans les centres spécialisés, si quelqu’un vient la demander, il va l’avoir. Mais c’est un parcours du combattant d’arriver là pour quelqu’un qui n’est pas HSH !
T. : Il s’agirait donc de simplifier les recommandations pour que les soignants s’en saisissent mieux ?
D.C. : Oui, il faut une action auprès des professionnels. On discute depuis quelques temps déjà d’une mise en œuvre hors de l’hôpital. Comme toujours, ce n’est pas un seul élément qui va être déterminant et il faut agir sur plusieurs facteurs à la fois. Il faut par exemple différencier la communication en fonction des publics. Pour l’instant, elle est surtout focalisée sur les HSH. Beaucoup de gens ne sont pas du tout au courant que la PrEP existe et qu’elle pourrait être utile pour eux.
T. : Mais c’est en fait l’Etat qui n’a pas mis en place de communication en direction d’autres publics. Les seuls à l’avoir fait, ce sont les associations Aides et Afrique Avenir.
D.C. : L’Etat ne peut pas faire des campagnes pour quelque chose qui n’est pas recommandé. Il faut donc que les recommandations évoluent sans tarder. Après, d’autres actions pourraient se mettre en place plus facilement.
T. : Dans l’arsenal préventif, le traitement post-exposition reste peu documenté. Est-ce un outil marginal au point qu’on ne juge pas utile d’en organiser le suivi à l’échelle nationale ?
D.C. : Comme toujours, on voudrait avoir des données sur tout, tout le temps. Mais au fond, la crise actuelle a montré que ce n’était pas si facile d’avoir des outils pertinents. Faut-il vraiment rajouter des tâches au personnel des urgences ? Personnellement, je n’en suis pas convaincue. On dispose de données indirectes qui montrent que le recours au TPE est le fait de populations très exposées, et notamment des HSH. Bien sûr, il faut que ce recours soit maintenu, mais au fond, les vraies pistes préventives sont le traitement des personnes vivant avec le VIH et la PrEP. Le TPE existe, il faut qu’il soit promu, mais, à mon avis, il ne peut pas jouer un rôle majeur dans le contrôle de l’épidémie.
T. : De manière générale, quelles sont les leçons à retenir si l’on considère les différents moments qui vont du dépistage au contrôle de la charge virale ?
D.C. : En termes de cascade, la situation en France n’est pas mauvaise comparée à celle d’autres pays d’Europe. On dépasse 73% de contrôle de la charge virale dans l’ensemble des personnes vivant avec le VIH depuis plusieurs années. Mais si cet indicateur a été utile pour mobiliser bien des pays, il n’est pas le plus utile dans une situation comme celle de la France. On le voit très bien dans le groupe dont les résultats sont les meilleurs, le groupe des usagers de drogues. Majoritairement, ce sont des gens qui ont été contaminés il y a longtemps et les nouvelles infections sont rares. Cela n’empêche pas qu’il y ait des délais longs dans ce groupe entre infection et diagnostic. Quand on est dans une situation où les gens sont peu dépistés, peu traités, il faut améliorer globalement la situation. Mais dans une situation assez bonne, comme c’est le cas en France, il faut principalement chercher à réduire le délai en infection et diagnostic : c’est cet indicateur qui est pertinent. Les indicateurs fournis par une cascade ne sont pas suffisants pour apprécier la dynamique d’une situation. En fait, la cascade renseigne plus sur une situation passée, sur le poids de l’épidémie antérieure.
T. : Se dirige-t-on vers de nouveaux indicateurs ?
D.C. : Au niveau international, je ne sais pas. Quoi qu’il en soit, la cascade de la prise en charge a tout de même permis de dynamiser les équipes pour avoir des données qui souvent n’étaient pas disponibles. Maintenant, quand on a de bonnes performances, il ne faut pas baisser les bras. Il y a encore des points sur lesquels agir. La seule voie d’amélioration en France, c’est vraiment la réduction du délai entre infection et diagnostic, dans la mesure où les gens diagnostiqués sont traités et ont une charge virale contrôlée dans leur immense majorité, et le renforcement de l’accès à la PrEP.
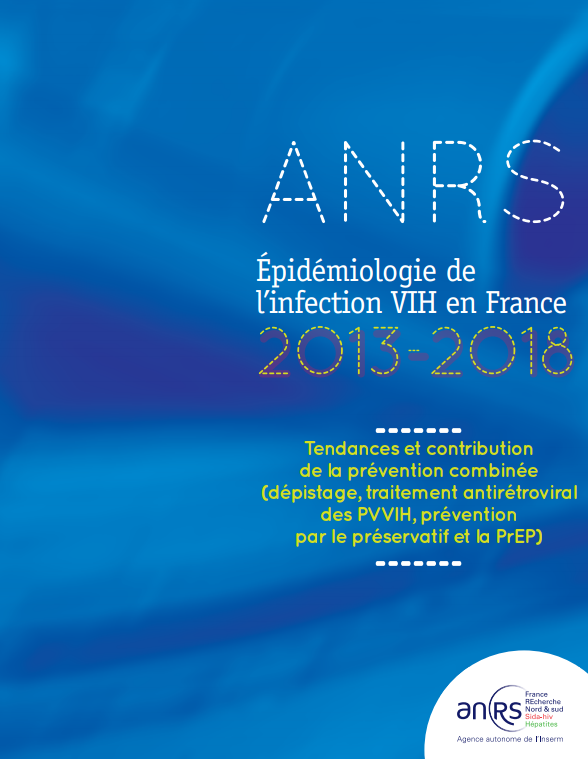
[i] Lancé à Paris en 2014, le réseau « Les villes s’engagent », qui a pour partenaires l’ONUSIDA, la Ville de Paris, l’International Association of Providers of AIDS Care et ONU-Habitat, sert à soutenir les villes prioritaires dans l’accélération de leur riposte au VIH.
[ii] Menée à compter du1er juillet 2019 à Paris et des Alpes Maritimes, cette opération permet à toute personne de se faire dépister pour le VIH en laboratoire sans ordonnance ni rendez-vous.
[iii] Soutenu par l’ANRS, ce projet porte sur l’acquisition du VIH et les parcours de vie d’hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes nés à l’étranger et vivant en Ile-de-France.
 Dominique Costagliola : « Il faut réduire le délai entre infection et diagnostic »
Dominique Costagliola : « Il faut réduire le délai entre infection et diagnostic »