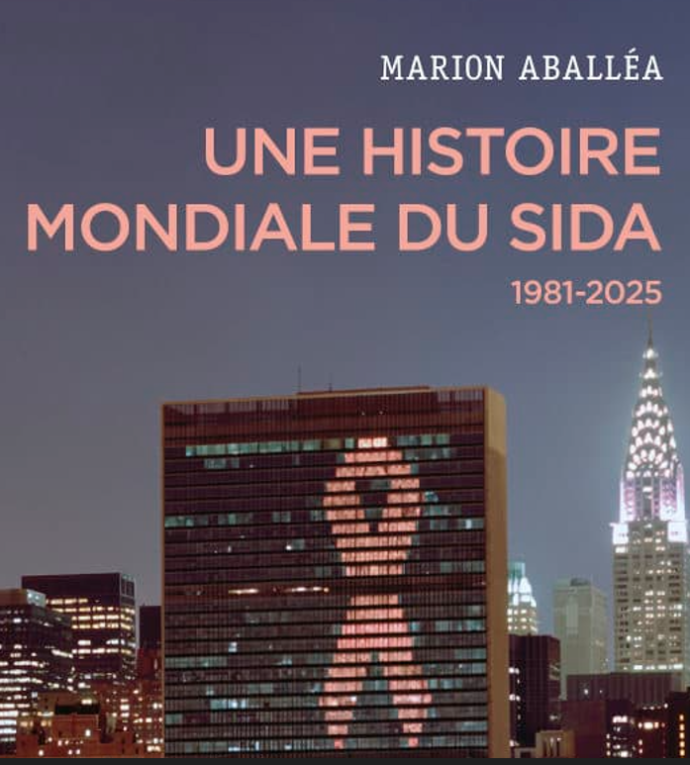Depuis 2016, à Paris, une salle de consommation à moindre risque, rebaptisée Halte “soins addictions” accueille en moyenne 800 personnes par an. Le but est de permettre aux usagers de drogues par voie injectable de consommer en limitant au maximum les risques. Chef de service de cette salle située dans le quartier de la gare du Nord, Jamel Lazic est convaincu de la nécessité du dispositif et appelle à sa multiplication.
Transversal : Quels sont les risques de santé publique que ce type de lieu permet d’éviter ?
Jamel Lazic : En plus de prévenir le risque de contracter le VIH et/ou l’hépatite C par la distribution de matériels stériles à usage unique dans un espace propre, les usagers réduisent les conséquences liées à une mauvaise pratique de l’injection, comme les abcès ou l’overdose. Nous n’avons ainsi été confrontés à aucun cas mortel, car, sur le plan médical, nous pouvons réagir immédiatement. À ma connaissance, il en est de même dans toutes les salles de consommation à moindre risque qui existent à l’étranger.
Et puis, ici, les usagers de drogues sont protégés de la violence de la rue et du risque de se faire voler ou interpeller par la police. C’est un refuge qui leur permet d’échapper au regard des passants et où ils sont accueillis avec une bienveillance qu’ils ne reçoivent que rarement ailleurs.
T. : Proposez-vous d’autres services ?
J. L. : Tout à fait. La salle est une porte d’entrée vers le soin avec un service de consultation médicale et sociale, sans rendez-vous.
Chaque année, nous réalisons une centaine de Trod (test rapide d’orientation diagnostique) pour le VIH, et les cas de résultat positif sont exceptionnels ; nous n’en avons dénombré aucun ces trois dernières années. Ce qui n’est malheureusement pas le cas pour l’hépatite C, dont la prévalence se situe autour de 30 %.
En outre, la salle revêt une vraie dimension sociale. C’est d’abord un lieu de sociabilité et un endroit où nous pouvons fournir aux usagers des possibilités d’hébergement et une orientation vers les services sociaux afin qu’ils obtiennent, par exemple, une carte d’identité, une affiliation à la Sécurité sociale, une domiciliation ou un compte en banque.
T. : Six ans après son ouverture, quel bilan dressez-vous ?
J. L. : L’évaluation scientifique, commandée par la Mildeca [Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives] à l’Inserm entre 2013 et 2021, conclut à des effets positifs incontestables en matière de santé publique et de tranquillité publique.
Avant l’ouverture de la salle, nous pouvions ramasser dans le quartier, en quelques heures, 100 à 150 seringues. Aujourd’hui, quand nous en trouvons 15, c’est vraiment exceptionnel !
Un petit groupe de riverains entretient toujours la polémique en postant régulièrement des photos choc sur Internet, qui bénéficient d’un fort relai médiatique, mais d’autres collectifs de riverains, comme Action Barbès ou Parents SCMR 75, reconnaissent l’amélioration de la vie dans le quartier et soutiennent notre implantation, car ils savent qu’ils ont désormais un interlocuteur qui peut intervenir rapidement si nécessaire. Pour preuve de leur adhésion, de nombreuses personnes nous proposent fréquemment leur service en tant que bénévoles.
T. : Quel est le profil des personnes qui viennent à la salle ?
J. L. : Ce sont très majoritairement des hommes, nous n’accueillons que 15 % de femmes. Les deux tiers déclarent ne pas avoir de domicile fixe. Beaucoup vivent seuls et 40 % sont en rupture de soin. La plupart d’entre eux ont un lourd parcours d’errance dans la rue, parfois dix, quinze ou vingt ans. De nombreuses personnes souffrent de troubles psychiatriques non diagnostiqués et 20 % ont un parcours de migration. Parmi ces derniers, beaucoup viennent de Russie et des pays de l’Est où la prévalence du VIH au sein de cette population clé est très élevée. Cela dit, nous accueillons aussi des personnes insérées, qui ont un travail, et des étudiants qui ont une vie de famille, mais c’est une minorité.
T. : Est-ce que la capacité de la salle est suffisante pour Paris ?
J. L. : La fédération Addiction estime qu’il faudrait quatre nouvelles salles à Paris, de taille différente, à proximité des lieux de consommation de crack (notamment dans le nord-est parisien et le 93), dont certaines resteraient ouvertes la nuit.
Il faudrait aussi une salle pour les usagers de drogues par inhalation. Nous avions 12 places pour cette pratique, qui étaient réservées aux personnes qui ont également une pratique d’injection, mais nous avons dû fermer cet espace au moment du Covid. Et depuis, pour des raisons politiques, il n’a pas été rouvert.
T. : Quelles sont les mesures qui pourraient encore être prises ?
J. L. : Ouvrir de nouvelles salles. Nous sommes clairement à la traîne par rapport à des pays comme la Suisse, la Hollande, l’Allemagne ou l’Espagne. La seule ville de Barcelone concentre par exemple 10 à 12 salles comme la nôtre. Ces pays ont une logique très pragmatique du problème, alors qu’en France nous restons fixés sur la question de la sécurité publique.
Cependant, notre pays est à la pointe dans la prescription de traitements de substitution aux opiacés, tels que la méthadone ou le Subutex®, mais les autorités sanitaires ont exigé d’y ajouter des excipients afin de dissuader l’administration par voie injectable. Le problème est qu’un certain nombre d’usagers continuent de s’injecter le produit par habitude et parce qu’ils ont ainsi besoin d’une plus petite quantité pour parvenir au même effet. Ils subissent alors les conséquences très délétères de ces excipients. Il serait intéressant de pouvoir leur proposer un traitement de substitution injectable, comme cela se pratique en Hollande.
Cela permettrait également de réduire la prostitution et le deal, lesquels financent l’héroïne qui, quand elle est achetée dans la rue, peut être coupée. Comme on n’en connaît jamais le titrage, il existe un risque permanent de surdosage et donc, d’overdose.
* Une deuxième salle existe à Strasbourg.

 Drogues : le cercle vertueux des salles de consommation
Drogues : le cercle vertueux des salles de consommation