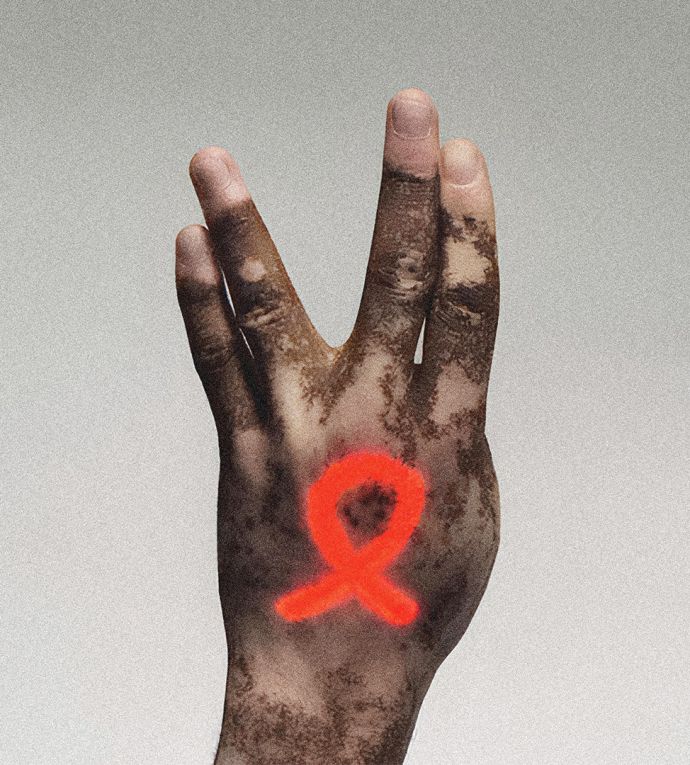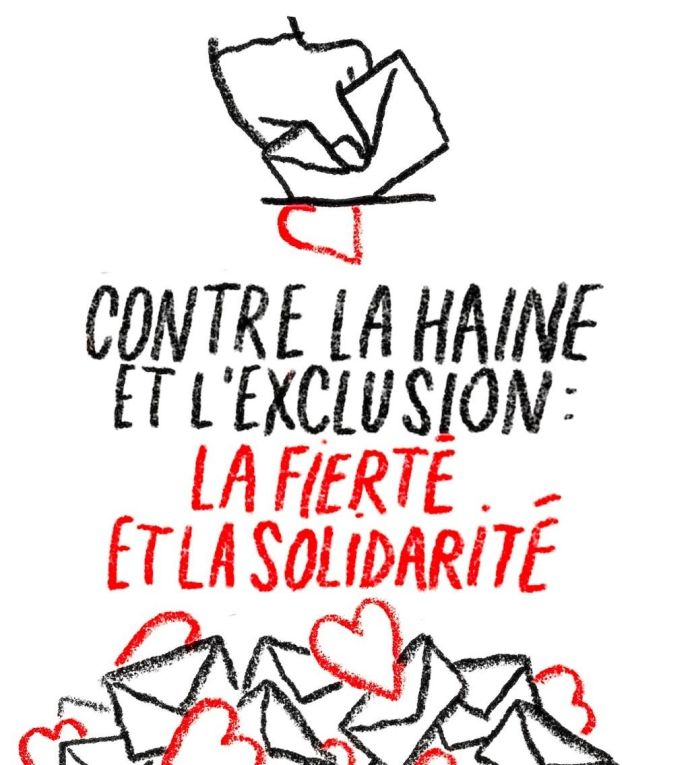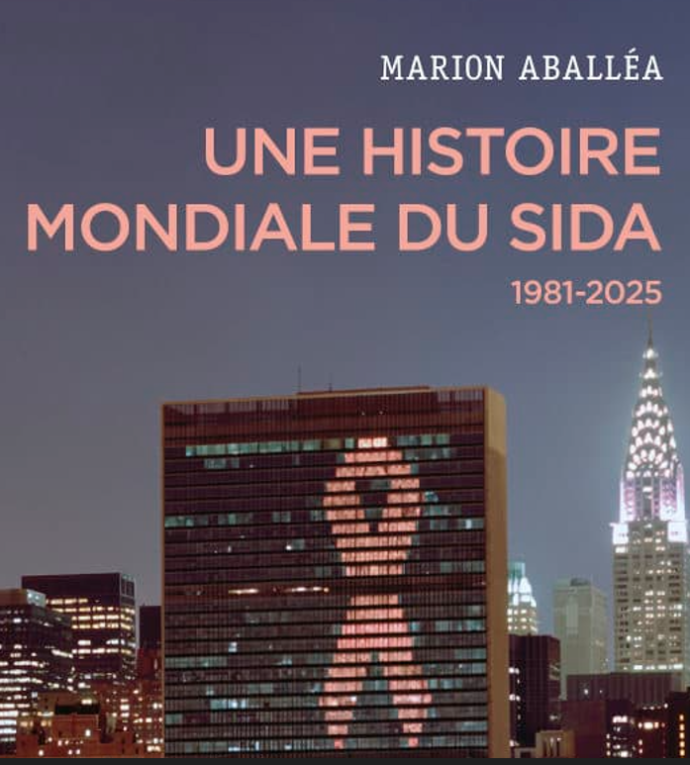Figure incontournable de la recherche sur le VIH, Françoise Barré-Sinoussi a été décorée grand-croix de la légion d’honneur en ce début d’année 2017. L’occasion de revenir sur son parcours et son engagement exceptionnel avec cet entretien réalisé par Laure Adler.
Est-ce qu’il y a une retraite pour les gens comme vous ?
Oui (rires), bien sûr qu’il y a une retraite. En fait, ma vision de la retraite n’est pas d’arrêter toute activité. C’est simplement une page qui se tourne. Et je dirais que c’est avoir la possibilité de sélectionner uniquement les activités que l’on a vraiment envie de faire.
Oui, mais cela veut dire aussi le moment des bilans. En êtes-vous au moment des bilans ou êtes-vous toujours dans une course?
Non, je ne suis pas à un moment de bilan. Le bilan, je l’ai déjà fait depuis longtemps. Et puis, c’est progressif: dans le milieu de la recherche, on fait régulièrement des bilans de nos activités. Donc, il ne s’agit pas de faire un bilan à ce moment-là, précisément.
Mais je parle d’un bilan personnel, pas seulement scientifique…
Même personnel! D’ailleurs, j’ai fait un bilan personnel à d’autres reprises et pour d’autres raisons dans ma vie… pour des raisons personnelles. Ce bilan est fait. Je pense qu’à un moment donné il faut laisser la place à la jeune génération de chercheurs. Cela fait partie de la vie de permettre aux chercheurs avec lesquels on a travaillé depuis des années de prendre leur indépendance totale. J’ai toujours essayé, en tout cas pour les chercheurs qui devenaient des seniors, de leur donner cette indépendance. Mais je crois qu’il faut aller plus loin et leur dire: «Ça y est, là vous êtes partis, vous êtes reconnus au niveau international, vous n’avez plus besoin de moi. Et il faut franchement que vous apparaissiez sans avoir une étiquette “Barré-Sinoussi” derrière vous.»
Je pense qu’à un moment donné il faut laisser la place à la jeune génération de chercheurs.
C’est pas mal d’avoir une étiquette «Barré-Sinoussi»! Et d’ailleurs, qu’est-ce que cela veut dire?
Je pense qu’il est bien qu’ils aient leur propre nom. Ce n’est pas très bon non plus d’avoir papa ou maman à vie derrière soi…
Êtes-vous papa ou maman?
Oh, ils m’appellent «mamie» [rires]!
C’est affectueux, alors?
Ils m’appellent «mamie Nobel» [rires].
C’est pas mal, «mamie Nobel»!
C’est très gentil et j’adore ça [rires]. J’ai toujours été très liée à mon équipe. On constitue une sorte de famille et c’est pour cela que je fais la comparaison avec la famille. Et il y a un moment où les enfants doivent partir de la maison. Hélas, il y a également un moment où les parents doivent partir de la maison pour justement leur laisser leur liberté et la liberté de s’exprimer totalement, en dehors de moi.
Peut-être pourriez-vous expliquer ce qu’est votre esprit de recherche, puisque vous formez des jeunes générations qui seront sur le pont de cette recherche? Quand on regarde votre parcours, votre itinéraire familial, on se dit que rien ne vous prédisposait à chercher. Comment qualifieriez-vous cet esprit qui vous caractérise?
Effectivement, personne dans ma famille n’a jamais été chercheur. C’est quelque chose qui m’a attirée à un moment de ma jeunesse, sans savoir réellement à quoi cela correspondait. Jusqu’au jour où j’ai mis un pied dans un laboratoire et où je me suis aperçue que c’était bien là ma voie. Et que c’était en quelque sorte une passion. Je n’ai jamais réellement considéré la recherche comme un métier. C’est pouvoir se remettre en question continuellement, et je pense que c’est important dans la vie. C’est pour cela qu’il n’y a pas de moment précis pour réaliser un bilan. Un chercheur doit en permanence se remettre en question, quel que soit son âge. On ne détient jamais la vérité entière. Il faut faire ce métier non pas pour soi-même, mais pour essayer de contribuer pour les autres. Dans notre milieu de la recherche biomédicale, on doit tenter d’apporter, pas à pas, des solutions au bénéfice des personnes qui sont touchées par des pathologies. J’ai donc toujours perçu ce métier, si je puis dire, ou plutôt cette mission comme…
Une vocation, diriez-vous?
Oui, peut-être une vocation, faite pour donner aux autres. Se donner pour les autres. Et c’est cela qui a toujours conduit ma carrière… Le fait aussi que je sois à Pasteur. La mission «pasteurienne» correspondait bien à cet esprit de travailler pour les autres. Je suis donc ravie d’avoir fait une carrière dans cette maison, même si je n’ai pas été un chercheur financé par l’Institut Pasteur, mais majoritairement par l’Inserm, avec un salaire Inserm. D’ailleurs, le multi-institutionnel est pour moi très important, tout comme le multidisciplinaire ou le transversal entre la recherche fondamentale et la recherche clinique.
Est-ce une marque de la science d’aujourd’hui?
Je pense que cette marque de la science vient du VIH.
Le multi-institutionnel est pour moi très important, tout comme le multidisciplinaire ou le transversal entre la recherche fondamentale et la recherche clinique.
Pensez-vous que le VIH/sida et les recherches que vous avez menées ont conduit vers cette interdisciplinarité?
Oui! Depuis quand parle-t-on de recherche translationnelle? Depuis le VIH/sida. Avant, ce mot n’était pas utilisé. Je pense réellement que cela vient de l’exemple des leçons du VIH/sida. L’interaction forte avec les patients et les représentants de patients vient de là. Il existait, et il existe toujours, des associations de patients dans bien d’autres champs de recherche, dans d’autres domaines pathologiques, mais cette interaction avec le milieu associatif et les chercheurs a été créée par le VIH.
D’où vient votre altruisme, Françoise Barré-Sinoussi? Vient-il de la manière dont vous avez été accueillie dans cet institut [Pasteur]?
Je ne sais pas. Sans doute y a-t-il une part de génétique? Je n’en sais rien. Cela a aussi à voir avec l’éducation reçue dans mon environnement familial. Ensuite, effectivement, l’arrivée à Pasteur, le travail avec des personnalités très enthousiastes telles que Jean-Claude Chermann, par exemple, a certainement compté. D’avoir également rencontré des chercheurs à l’étranger, notamment aux États-Unis, qui avaient la même perception de la recherche… Je pense que c’est un ensemble, qui oriente en même temps une carrière. Et puis le VIH a été pour moi un tournant. Un tournant parce que c’était la première fois que je découvrais que l’on pouvait sortir de son laboratoire et avoir des contacts proches avec nos collègues les cliniciens, le milieu médical dans sa globalité, rencontrer des personnes touchées par une pathologie, échanger avec elles et interagir avec le milieu associatif. Cela a été une grande découverte. Ainsi que la découverte des pays à ressources limitées, qui a fortement marqué l’évolution de ma carrière à partir de 1985.
Comment avez-vous compris ce moment où cette pathologie, que vous allez nommer par le sida, dépassait le ghetto des «quatre H», comme on l’avait alors désignée? Car c’est très compliqué à comprendre dans l’histoire des mentalités aujourd’hui.
Dès le départ, je n’ai pas compris pourquoi on utilisait cette nomination des «quatre H». Pourquoi, en 1984, était-il écrit dans certains journaux anglophones: «Les chercheurs français ont découvert le virus de l’homosexualité.» C’est quelque chose qui m’est resté et qui a peut-être induit chez moi un certain activisme, parce que je trouvais que c’était inacceptable de traiter des êtres humains avec une telle étiquette dans la presse. J’ai été profondément choquée. Et je reste choquée, aujourd’hui, de ces attitudes de discrimination, de stigmatisation vis-à-vis des populations. Il est clair que lorsque l’on travaille comme moi en recherche biomédicale sur certaines pathologies, quelles qu’elles soient, on se fiche royalement de savoir si les personnes sont homosexuelles, prostituées, lesbiennes, droguées… On est là pour apporter un bénéfice à tous les patients, quels qu’ils soient et où qu’ils soient de par le monde.
Lorsque l’on travaille comme moi en recherche biomédicale sur certaines pathologies, quelles qu’elles soient, on se fiche royalement de savoir si les personnes sont homosexuelles, prostituées, lesbiennes, droguées…
Et comment avez-vous compris la propagation du virus?
Je crois que c’était dans les années 1984, entre 1984 et 1985, dès l’instant où on a eu des contacts avec nos collègues africains ou qui travaillaient en Afrique et que l’on a compris qu’effectivement beaucoup de malades mourraient du sida dans ce continent sans que cela ait été reconnu au préalable. À l’époque, les autorités africaines ne voulaient pas en parler parce qu’elles craignaient que cela nuise à l’image de leur pays. Ce sont des expériences fortes pour des chercheurs comme moi: voir ce qui se passe en Afrique, voir le poids du passé, celui de l’économie du pays, de la politique, des traditions, de la culture… J’ai beaucoup, beaucoup appris. J’ai eu énormément de chance grâce –si je puis dire– au VIH/sida. J’ai vécu des expériences fabuleuses.
Par exemple?
Rencontrer des personnes qui ont des valeurs de tolérance, de solidarité que l’on retrouve aujourd’hui beaucoup plus difficilement dans nos pays riches. Des personnes qui ont une joie de vivre que l’on aimerait bien voir parfois chez nous: des personnes paralysées et qui continuent de chanter, d’essayer de danser… J’avoue que ce sont des leçons de vie. Et quand on revient dans nos pays, on a une autre perception de notre monde à nous.
Quels sentiments avez-vous éprouvés au moment où vous avez compris que vous aviez réussi à identifier le VIH? Vous parlez d’un assemblage de puzzle.
Oui, je dis toujours que c’est un puzzle, parce que le moment où on détecte une activité enzymatique qui pourrait être celle d’un nouveau virus n’arrive pas comme cela. Cela se construit pas à pas. Et c’est un sentiment extraordinaire lorsque les résultats s’assemblent comme les pièces d’un puzzle. Je n’avais jamais vécu ça dans ma vie de chercheur et j’ai eu le bonheur, si je puis dire, de le vivre au début des années 1980. On a émis des hypothèses, on a réalisé des expériences en fonction de ces hypothèses et les résultats correspondaient exactement à ce que l’on avait imaginé. On peut donc mettre la pièce tout de suite dans le trou manquant. Je n’avais jamais vécu, entre guillemets, une telle succession de succès!
Cela signifie-t-il qu’il y a une logique dans cette recherche, dans votre recherche?
Mais pour être chercheur, il faut être logique. Il faut être rationnel. C’est une des qualités que doit avoir un chercheur.
Il faut éliminer des hypothèses.
Oui, il faut éliminer des hypothèses. Et plus les choses deviennent complexes –on le voit aujourd’hui y compris dans le domaine du VIH–, plus on émet des hypothèses, lesquelles ne se confirment pas dans la majorité des cas. Mais ce n’est pas grave. Cela fait aussi partie de la vie du chercheur. Et c’est justement à partir des résultats négatifs que l’on apprend et que l’on élabore de nouvelles hypothèses. C’est du classique dans le quotidien du chercheur. Et c’est pour cette raison que de constater pendant ces premières années que tout allait dans le bon sens était quand même exceptionnel. Pour moi, c’était quelque chose d’extrêmement nouveau.
Ce sont des expériences fortes pour des chercheurs comme moi: voir ce qui se passe en Afrique, voir le poids du passé, celui de l’économie du pays, de la politique, des traditions, de la culture…
Avez-vous l’impression que finalement les découvertes fondamentales, comme celles que vous avez faites, correspondent à des états particuliers de la société et de la science ou, pour le dire un peu brutalement, est-ce que quelqu’un d’autre que vous aurait pu trouver, peut-être un an après vous, la même chose?
Oui, bien évidemment, quelqu’un d’autre aurait pu le trouver après ou en même temps. Il suffit d’avoir les mêmes idées au même moment, mettre en place les mêmes technologies et les résultats tombent. Je dis d’ailleurs toujours aux jeunes chercheurs : « Essayez d’être là au bon moment.»
Ça veut dire quoi le bon moment?
Concernant le VIH, il s’agissait classiquement, je dirais, d’une épidémie émergente. Un certain nombre de recherches avaient déjà été effectuées pour identifier l’agent responsable, mais aucune des hypothèses ne collaient. Donc, être là au bon moment, c’est proposer une nouvelle hypothèse –qui nous a d’ailleurs été apportée par les cliniciens, puisque ce sont eux qui sont venus nous voir pour nous demander: «Est-ce que vous croyez qu’un rétrovirus peut être la cause de cette maladie?» C’est pour cette raison que je dis que le contact avec lescliniciens est essentiel.
Donc la recherche pure, cela n’existe pas?
Cela dépend de ce que vous entendez par recherche pure. Mais, pour moi, oui, c’est de la recherche pure. Il s’agit simplement d’avoir les bons contacts, les bonnes hypothèses et les bons outils technologiques, c’est-à-dire des outils disponibles au moment où justement on veut vérifier une certaine hypothèse. Et il faut éviter les dogmes. C’est aussi quelque chose que je dis souvent aux jeunes chercheurs: «Attention! Attention aux dogmes.» Parce que le milieu de la recherche vit parfois sur des dogmes anciens… Acceptés définitivement dans l’esprit de tout le monde. Or rien ne doit être définitivement accepté dans le milieu de la recherche.
Principe de l’incertitude, alors.
C’est ce que je disais tout à l’heure: il faut savoir toujours se remettre en question.
Le questionnement comme principe et un socle de connaissances.
Oui, il faut toujours se questionner. C’est pourquoi il ne faut pas partir de dogmes, mais se dire qu’il faut rester ouvert. C’est ce que l’on a fait. On n’est pas parti de l’idée, comme nos amis les cliniciens le pensaient, d’un HTLV [rétrovirus]. On s’est dit: «Attendez, là il y a quelque chose qui ne colle pas dans votre hypothèse.» Mais c’est aussi parce que l’on avait un fond de connaissances scientifiques qui nous permettait de dire: «Non, ça ne fonctionne pas votre truc. Un rétrovirus, pourquoi pas? Mais ça ne colle pas. On ne va donc pas partir de l’hypothèse que c’est un HTLV, mais plutôt de celle que c’est peut-être un rétrovirus. De cette approche-là, on essayera d’identifier ce virus et de vérifier s’il appartient à la famille des rétrovirus.» C’est pour cela que je dis qu’il ne faut pas partir de dogmes ou d’idées préconçues. Il faut être beaucoup plus ouvert. Et puis c’est vrai que les technologies avaient bien avancé. On n’aurait jamais pu isoler ce virus s’il n’y avait pas eu au préalable la découverte de l’interleukine2, qui permettait la culture des lymphocytes en laboratoire. Cet ensemble doit être pris en considération: l’évolution de la science, l’évolution des techniques et, bien sûr, l’évolution de nos connaissances et des interactions entre les chercheurs.
Rien ne doit être définitivement accepté dans le milieu de la recherche.
Vous êtes une chercheuse engagée, comment avez-vous compris dès le départ qu’il fallait travailler avec les associations?
Cela s’est produit naturellement. Il se trouve qu’au début des années 1980, j’ai très rapidement été en contact avec l’association Aides, car Daniel Defert m’avait demandé de venir expliquer ce qu’était ce virus que l’on avait isolé et où allait la recherche. Un excellent contact s’est établi avec lui et les représentants du milieu associatif présents. J’y allais régulièrement et c’est comme ça que je suis devenue amie avec Daniel et bien d’autres. Dans ces mêmes années, je me retrouvais, à l’inverse, dans des situations incroyables: des patients de France et de l’étranger débarquaient à l’Institut Pasteur. Certains avaient dépensé tout leur argent pour acheter un billet d’avion, car ils avaient entendu dire qu’à Pasteur on testait un traitement. Ils arrivaient dans un état physique et clinique dramatique, les hôpitaux français ne voulant pas les prendre en charge parce qu’ils étaient étrangers…
Il y avait déjà l’idée de la contagion…
Oui. Et moi d’appeler Aides et Daniel au secours en demandant: «Qu’est-ce que je fais?». Daniel m’a répondu: «Françoise, on va s’en occuper.» Voilà comment s’est créée cette interaction avec le milieu associatif.
Avez-vous l’impression que ce milieu associatif est toujours aussi solide?
Je trouve qu’il est moins battant! Et pourtant il devrait continuer à l’être. Il est moins battant probablement parce que les patients qui participent au milieu associatif vont bien, Dieu merci. Donc, il n’y a pas la même fougue enthousiaste qu’au début. En plus, après la découverte des antirétroviraux, en 1996, il s’est produit un élan au sein du milieu associatif pour l’accès au traitement qui a été extraordinaire.
Les associations ont-elles moins d’élan?
Oui. À la fois je le comprends et à la fois je le regrette, car on a encore terriblement besoin d’elles. On a besoin d’elles afin de mettre en place les outils que la science crée au cours des années, en termes de dépistage, de prévention, d’accès aux soins et aux traitements. On a également besoin d’elles pour le futur de la recherche dans le champ du VIH et au-delà de ce champ. À mon avis, l’action du milieu associatif doit être développée bien au-delà du VIH: les associations qui travaillent dans d’autres domaines médicaux doivent se développer sur ce modèle des relations entre chercheurs, médecins et patients, voire que des personnes issues de l’associatif deviennent elles-mêmes des chercheurs, comme on a pu et on peut encore l’observer dans le domaine du VIH. Je trouve cela merveilleux. Et on commence à le voir à l’étranger. Au mois de mars, j’étais au Vietnam et j’ai assisté à une réunion où plein de gens prenaient la parole. À un moment, une personne s’est exprimée, et j’étais incapable de dire si cette personne était médecin, chercheur ou appartenant au milieu associatif. On m’a dit plus tard :«Non, elle fait partie de telle association.» Cela fait plaisir.
Mais pensez-vous que le milieu médical français est prêt à accepter un entrisme des associations dans la perception médicale, qui est quand même très hiérarchique et hiérarchisée encore aujourd’hui?
Vous savez, je crois que c’était pareil au début des années «sida». Et, côté hiérarchie, c’était peut-être pire que maintenant. Trente ans après, les choses ont quand même un peu évolué. Je crois que le milieu médical, quand il comprend qu’il peut y avoir un bénéfice, y compris pour lui, peut s’ouvrir. On l’a vu pour les hépatites. Je me souviens qu’au début, surtout quand le gouvernement a décidé de regrouper la recherche sur les hépatites virales avec la recherche sur le VIH au sein de l’ANRS, un certain nombre de personnalités du milieu des hépatites n’étaient pas forcément très contentes et disaient: «Mais qu’est-ce que c’est que ça? Les gens du sida n’ont pas de leçons à nous donner.» Avec le temps, ils ont compris d’eux-mêmes le bénéfice qu’il y avait à travailler tous ensemble –et la communauté «sida» était restée très en retrait afin de ne pas les choquer. Aujourd’hui, je crois que ce sont les plus grands défenseurs de l’ANRS. Peut-être plus que les chercheurs qui travaillent dans le domaine du VIH. Voilà pourquoi je suis convaincue qu’avec l’expérience on peut y arriver.
À mon avis, l’action du milieu associatif doit être développée bien au-delà du VIH.
Meurt-on encore du sida en Occident?
Oui, cela arrive. Malheureusement. Cela arrive, car des personnes sont prises en charge trop tardivement. Car il existe ce que l’on appelle les mortalités «non classant sida»: les patients qui sont sous traitement depuis déjà très longtemps et qui développent des cancers, des maladies cardio-vasculaires, des maladies du système nerveux central, etc. Donc oui, on meurt encore, non pas directement du sida, mais de pathologies associées à l’infection par le VIH. Et c’est pour cette raison qu’à mon sens il y a un immense besoin, tant pour la recherche sur le VIH que pour la recherche sur des pathologies, comme le cancer, les maladies cardio-vasculaires, les maladies auto-immunes et celles dues au vieillissement… Il me paraît essentiel que ces communautés étudiant des pathologies différentes se rapprochent et travaillent les unes avec les autres.
Il y bientôt cinq ans, pour la Société internationale sur le sida [IAS], j’ai lancé l’initiative Towards an HIV Cure avec pour objectif d’aller vers les traitements qui permettraient une guérison. Mais je ne crois pas trop à la guérison, je pense que ce sera plutôt une rémission durable, ce qui sera déjà un grand pas. Et, il y a déjà trois ans, j’ai été convaincue qu’il fallait se rapprocher des chercheurs travaillant dans d’autres domaines, notamment celui du cancer, parce que les premiers médicaments utilisés pour les thérapeutiques du futur sont justement des anticancéreux. Il existe des analogies avec le VIH. Pourquoi les réservoirs viraux restent-ils présents chez les patients? On sait qu’il y a une prolifération des cellules qui contiennent le virus à l’état latent et cette prolifération fait penser à celle des cellules cancéreuses. Il existe un état d’inflammation qui joue un rôle dans l’évolution de la maladie ou la non-guérison chez des patients, y compris ceux sous traitement. Les anomalies d’inflammation existent également dans le cancer, dans les maladies liées au vieillissement, dans les maladies auto-immunes… Il y a tellement de choses en commun qu’il est grand temps que les communautés se rassemblent. Parce que sinon on n’y arrivera pas.
Les chercheurs qui, comme moi, travaillent depuis longtemps, trop longtemps peut-être, dans le domaine du VIH ne perçoivent plus certaines choses. Et c’est peut-être pareil pour les chercheurs qui travaillent dans le domaine du cancer. Si les deux communautés se réunissent, des hypothèses nouvelles, des questionnements nouveaux pourront émerger, donnant naissance aux traitements du futur pour le VIH et aussi peut-être pour le cancer. C’est donc très important. Il me semble que l’on est à ce point de jonction aujourd’hui. En 2013, à l’occasion des trente ans à l’Institut Pasteur, j’avais essayé de créer un petit atelier en mélangeant des communautés. Les personnes étaient contentes de se retrouver ensemble et cela s’est très bien passé. Il n’y avait pas beaucoup de personnes –je pense qu’il faut commencer avec peu de personnes–, mais cela n’a pas eu de suivi. Donc… il faut continuer.
Vous indiquez des champs de recherche nouveaux et, à vous écouter, on a vraiment l’impression que non seulement vos recherches ont été suivies d’effets pratiques et ont sauvé beaucoup de personnes, mais, en même temps, qu’il y a eu un principe épistémologique, c’est-à-dire que vos recherches ont accouché d’un nouveau type de recherche. Est-ce que vous pouvez vous faire entendre par les autorités de tutelle pour que ce que vous indiquez, et qui nous paraît très important en tant que citoyens, puisse être suivi d’effet?
Je pense que c’est passé. Je sais que Jean-François Delfraissy, [ancien directeur] de l’ANRS, partage complètement mon point de vue. Et je sais qu’à Pasteur la direction partage également mon point de vue.
Les choses vont donc bouger?
Oui, les choses vont bouger. À l’IAS, dans l’initiative vers une guérison, on a un conseil réunissant toutes les organisations internationales qui financent la recherche dans le domaine du VIH, au niveau américain et français. Malheureusement, je n’ai pas encore réussi à mobiliser la communauté européenne. Mais je sens que nos collègues néerlandais et suédois sont prêts à nous rejoindre. La Chine, l’Afrique du Sud, l’Australie et le Canada font partie de ce conseil. On a mis en place un groupe de travail de scientifiques internationaux qui donnent les grands axes prioritaires de la recherche. Ces axes sont approuvés par le conseil, qui lancera ensuite des appels d’offres et des recherches au niveau international et de façon la plus coordonnée possible. Cela s’organise des chercheurs vers les financeurs, mais pas seulement: on a mobilisé l’industrie pharmaceutique et le milieu associatif, présent au conseil. Car, pour moi, tout doit être fait dans la même philosophie du «tous ensemble».
Alors justement dans ce «tous ensemble», pouvez-vous nous préciser ce qui se passe en Afrique? Il y a eu beaucoup de problèmes d’identification de la maladie, puis d’accès aux soins, enfin on a dit que certaines firmes pharmaceutiques ne voulaient pas donner les médicaments appropriés… Qu’en est-il aujourd’hui?
D’abord, on ne peut pas parler de situation en Afrique de façon aussi générale que vous le faites. Je pense vous avez en tête l’Afrique du Sud, qui, pour moi, n’est pas forcément représentative à 100% de l’Afrique subsaharienne; l’Afrique du Sud étant quand même un pays émergent. En tout cas, comparativement à la République centrafricaine, je n’ai pas l’impression d’être en Afrique quand je suis en Afrique du Sud. Mais la situation a été réglée en Afrique du Sud. Malheureusement, elle a été réglée trop tard. C’était la position d’un président à un moment donné, le président Thabo Mbeki, et surtout de son gouvernement et de sa ministre de la Santé de l’époque. Ce sont des choses que l’on rencontre régulièrement dans d’autres pays. On peut parler de ce qui se passe dans les pays de l’Est…
Tout doit être fait dans la même philosophie du «tous ensemble».
Je ne sais pas, que se passe-t-il dans les pays de l’Est?
Rien! Justement. Ils estiment que les personnes touchées par le VIH sont des personnes hors société.
Ce que l’on appelait autrefois la relégation existe-t-elle encore?
Tout à fait. Mis à part la prison, c’est tout ce à quoi ils auraient droit… Quand on ne leur fait pas subir des sévices en prison, d’ailleurs, parce qu’ils sont gays. C’est incroyable, on se croirait être revenu à des siècles en arrière. Donc oui, il y a eu, il y a et il y aura toujours des politiques de ce type. Et c’est justement le rôle du «tous ensemble» de la communauté d’essayer de combattre cela.
En Afrique du Sud, la mobilisation de la communauté internationale a quand même eu un certain effet sur la politique de Mbeki; la voix de Nelson Mandela a été très importante. Et, actuellement, ce pays a une politique où les patients sont pris en charge. Malheureusement, certaines provinces d’Afrique du Sud ont atteint un tel niveau de prévalence de l’infection par le VIH que ce sera dur d’atteindre toutes les personnes et de diminuer l’épidémie. Mais on commence à avoir des chiffres encourageants depuis la prise en charge des personnes.
Donc, pour répondre à votre question sur l’Afrique, on ne peut pas comparer un pays de ce continent à un autre pays. Par exemple, j’adore parler du Sénégal avec des étudiants. Je leur pose toujours la question: «Quelle est la ville où il y a le plus d’infections par le VIH entre les États-Unis et le Sénégal?» Ils me répondent tous: «Une ville du Sénégal.» Et c’est totalement faux. Je leur dis: «Je suis désolée, mais c’est Washington DC [États-Unis].» Donc, arrêtez. Vous voyez, de fausses idées sont répandues. Lorsque des programmes nationaux très forts ont été mis en place, certains pays d’Afrique y ont très bien répondu, rapidement, contrairement à d’autres qui, malheureusement, à cause d’une politique à un moment donné…, mais pas seulement pour des raisons politiques. Comme en République centrafricaine où à un moment où tout allait mieux, le pays éclate et les patients ne sont alors plus pris en charge. C’est sûr qu’il existe toujours un risque de ce type d’événements. Prenons par exemple l’épidémie d’Ebola. Il y a eu une importante mobilisation, ce qui est tout à fait normal. Et je suis contente de constater que des associations qui travaillent dans le domaine du VIH se sont mobilisées pour Ebola. C’est exactement ce qu’il fallait faire. Et, justement, du fait de leur expérience dans le VIH, des chercheurs se sont également mobilisés. Mais, du coup, à la fois les patients séropositifs ont pris peur d’aller dans les structures de soins où ils étaient suivis, à la fois la communauté médicale était totalement débordée par Ebola et n’avait plus suffisamment de temps pour s’occuper de ces patients.
Dans de telles situations, tout peut arriver, que ce soit dû au contexte politique du pays, à la volonté des politiques du pays ou à des événements comme l’épidémie d’Ebola. Il faut être vigilant et s’efforcer à ce que ces situations aient le moins de conséquences possible pour les patients. C’est pour cette raison que l’on arrive à un moment où on se dit: «Attention, il ne faudrait pas perdre tout le bénéfice qui a été acquis pas à pas pour le VIH parce qu’il n’y a plus de financements internationaux, par exemple.»
Faudrait-il une nouvelle épidémie pour qu’il y ait de nouveau de l’argent?
Non, mais il ne faudrait quand même pas que les politiques attendent qu’il y ait une réémergence du VIH dans le monde.
Une réémergence est-elle possible?
Tout à fait. Si les fonds internationaux, le Fonds mondial, le Pepfar, la fondation Clinton, et j’en passe, s’arrêtaient, comment voulez-vous que les pays les plus pauvres continuent à prendre en charge les patients infectés par le VIH? Ils ne le pourraient pas. Si les traitements s’arrêtent ou s’ils ne sont pas pris régulièrement, savez-vous ce que cela donne? Des résistances aux antirétroviraux. Aujourd’hui, il n’y a plus de frontières. Tout le monde voyage. Et ces épidémies par des virus résistants aux traitements nous reviendront! Est-ce ce que l’on attend? Ce serait criminel. Il faut donc absolument maintenir les financements. Je comprends que l’on soit dans un contexte de contraintes économiques internationales, mais il faut choisir ses priorités.
La santé d’abord?
Pour moi, la santé est la priorité numéro un. Parce que sans la santé, il n’y a pas de vie. Et il n’y a plus de politique non plus d’ailleurs (rires).
Pour moi, la santé est la priorité numéro un. Parce que sans la santé, il n’y a pas de vie.
Avez-vous l’impression qu’en France il existe une politique de prévention cohérente? Et que pensez-vous de la dernière campagne de prévention contre le VIH?
Je pense que l’on pourrait faire mieux. En France, on a un peu levé le pied. Les campagnes de prévention ne sont pas aussi fortes qu’elles l’ont été à une certaine époque. En contrepartie, il faut se demander: «Est-ce que le grand public est prêt à aussi bien entendre les campagnes de prévention que dans les années 1980-1990?» Je ne le pense pas non plus.
Ne pensez-vous pas qu’il y a une banalisation?
Je crois que le grand public pense que ça suffit, qu’il faut arrête de parler du VIH, car tout va bien. Il existe un traitement et il n’y en presque plus chez nous [des cas d’infection]. Ce qui se passe chez les autres ne nous intéresse pas… Pourquoi continuer à en parler? Il est plus important de parler des maladies dont on parlait précédemment: le cancer, Alzheimer, les maladies liées au vieillissement. Ça oui, parce que cela nous touche. Mais ils oublient qu’ils peuvent également être touchés par le VIH au sein de leur famille.
Comment voyez-vous le futur de la recherche, de votre recherche, et de tous ces jeunes qui continueront votre travail?
D’abord, il y a de moins en moins de jeunes, de très jeunes chercheurs, intéressés par le domaine du VIH.
Pourquoi?
Parce qu’ils savent très bien qu’il y a moins d’argent qu’à une certaine époque! Et que vu la difficulté aujourd’hui pour les jeunes chercheurs d’accéder à un poste, à des financements, ils s’orienteront vers des pathologies où ils savent qu’il y a plus d’argent. S’ils décident de s’orienter vers la recherche, car, globalement, de moins en moins de jeunes prennent cette décision.
Pourquoi?
Parce que c’est le parcours du combattant!Parce qu’il y a de moins en moins de financements pour le statut de chercheur et de moins en moins de considération pour ce qui demeure quand même l’axe principal d’une politique de santé… future, mais aussi actuelle. C’est franchement très préoccupant. J’avoue que je suis inquiète pour le futur de la recherche en France, car j’estime qu’un pays qui perd une recherche d’excellent niveau devient un pays en développement. C’est exactement ce qui s’est passé dans les pays pauvres. Maintenant, on essaie petit à petit, grâce aux efforts internationaux, d’avoir dans certains pays, y compris les plus pauvres, un certain nombre de chercheurs –et il en manque énormément. Ce manque est dû à des raisons économiques. Ce n’est pas parce qu’un Africain n’a pas la capacité de devenir un chercheur de haut niveau, bien sûr que non, c’est tout simplement parce qu’il n’a jamais eu les moyens de le devenir. Si on fait pareil chez nous, on arrivera à la même situation.
Donc cette notion de progrès dans la recherche semblerait quasiment abandonnée par les tutelles politiques? Alors que c’est quand même le nerf de la guerre pour nous tous.
Je ne dis pas qu’elle est complètement abandonnée, mais selon les contextes économiques, ils font des priorités.
Est-ce la même situation dans d’autres pays européens?
Pour un bon nombre d’entre eux, oui. Récemment, j’étais en Suède où une réunion avait été organisée pour justement parler des priorités de la recherche dans le domaine du VIH, car très peu de financements sont actuellement alloués à ce domaine dans ce pays. Il s’agissait d’essayer de remobiliser un petit peu les politiques sur cette question. Donc oui, c’est malheureusement pareil dans beaucoup de pays européens. L’Italie, je n’en parle pas; l’Espagne, c’est catastrophique; en Allemagne, il n’y a plus beaucoup de financements non plus. Il reste la Grande-Bretagne et la France, mais pour combien de temps? Je ne sais pas. Et puis, si on sort de l’Europe, on arrive aux États-Unis, où en ce moment, à l’Institut national de la santé (NIH), la situation est tendue au sujet de la répartition du budget alloué à la recherche sur le VIH par rapport à d’autres pathologies. Donc… c’est mondial.
Avoir réussi, finalement, vous donne des handicaps. C’est tout de même extraordinaire comme situation!
Ce n’est plus prioritaire; il faut passer à autre chose.
Quels seraient vos vœux pour le futur de la recherche, vous continuerez de toute façon à vous battre, non?
Oui, tant que je pourrai [rires]! Mes vœux pour l’avenir de la recherche seraient de poursuivre les travaux dans le domaine du VIH et bien sûr dans le domaine des nouveaux traitements qui permettraient d’aller vers une guérison ou tout du moins une rémission permanente, durable. De développer la recherche vaccinale, même si on en est loin. Et justement d’avoir une recherche très fondamentale, parce que si on veut évoluer vers une recherche vaccinale pour le VIH et, au-delà du VIH, pour d’autres pathologies, il faut une recherche très fondamentale, de base, qui malheureusement souffre de difficultés financières, il faut dire ce qui est. Sidaction, heureusement, finance surtout de la recherche fondamentale et je crois que tous les chercheurs en sont réellement très ravis, parce que la recherche fondamentale manque terriblement. Et pourtant, tout part du fondamental. Sans ça, pas de recherche clinique ni d’application de la recherche. Mon vœu est donc de continuer à promouvoir la recherche de haut niveau en recherche fondamentale, de stimuler la recherche translationnelle et les interactions entre recherche clinique et recherche fondamentale. Car je ne supporte pas la vision du chercheur qui travaille dans le domaine du fondamental isolé dans son laboratoire. Il faut se battre contre cela, il faut sortir ces chercheurs de leur laboratoire et leur faire visiter les milieux hospitaliers, rencontrer des patients, afin qu’ils comprennent pourquoi ils recherchent. Mais ce n’est pas de leur faute, les pauvres. Et ils ne doivent pas chercher dans le but d’avoir un beau CV avec une belle liste de publications, avec un «pack» facteurs qui les aidera à trouver des postes et des financements. Non! Si être chercheur, c’est être ça, je pense qu’en fin de carrière, ils ne seront sûrement pas satisfaits.
Mais il n’y a pas de fin de carrière, manifestement… Vous en êtes l’exemple le plus abouti.
Si, il y a des fins de carrière: depuis le 1erseptembre, je n’ai plus de laboratoire.
Cela vous manque-t-il ?
Cela fait des années que je ne travaille plus à la paillasse, comme on dit dans notre jargon, donc de ce côté-là, cela ne me manquera pas. Cela fait des années que je suis devenue plutôt une «administrative» de la recherche. Et puis cela ne me manquera pas dans le sens où les personnes qui ont travaillé avec moi pourront continuer dans de bonnes conditions. Je suis donc plutôt contente que le laboratoire soit fermé dans ces conditions-là.Je pense que dans la carrière d’un chercheur, il existe différentes phases: des moments où on est à 100 % à la paillasse, d’autres où on commence à rédiger des demandes de crédit tout en continuant à être à la paillasse. Puis, la phase où on devient avant tout administratif, où on supervise la recherche des autres et où on participe à la formation. C’est progressif. C’est pour cela que quand un laboratoire ferme, cela fait partie de la vie du chercheur, mais cela ne signifie pas que tout s’arrête. Et, comme je le disais, certaines choses se poursuivent, comme dans des activités où il s’agit de stimuler les partenariats entre chercheurs, les partenariats institutionnels. Il me semble que ce sont également des choses importantes que l’on peut faire.
Mes vœux pour l’avenir de la recherche seraient de poursuivre les travaux dans le domaine des nouveaux traitements qui permettraient d’aller vers une guérison ou tout du moins une rémission permanente, durable, et de développer la recherche vaccinale.
Une dernière question, Françoise Barré-Sinoussi, on est dans votre petit bureau à l’Institut Pasteur, il y a une très belle photo derrière vous…
Il n’est pas si petit [ce bureau]. Vous n’avez pas vu le précédent [rires]!
Parlez-moi de cette magnifique photo.
Je l’ai reçue d’Afrique du Sud. Cette année, j’ai été nommée –comme dans bien d’autres endroits– docteur honoris causa de l’université de la province KwaZulu-Natal. Cette photo a été prise lors de la cérémonie, à Durban, au mois d’avril ou mai…
Encore une question: il y a des cartons, pourquoi ne les avez-vous pas ouverts?
Il y a quelques semaines, le bureau en était rempli! Des cartons que je n’avais pas ouverts depuis le déménagement. J’ai fait beaucoup de tri au mois d’août –j’ai d’ailleurs beaucoup jeté– et ceux-là sont justement ce qu’il reste des armoires: mettre ce que je veux garder dans les cartons pour m’apprêter à déménager dans un autre endroit.
Et où?
Ce sera dans Pasteur, mais de l’autre côté de la rue. C’est en travaux pour l’instant et ce sera un plus petit bureau [rires].
La toute dernière question: trouvez-vous que l’âge compte quand on est comme vous tellement vaillante, ouverte, éveillée dans ce monde de la recherche dont vous maîtrisez tous les codes? N’est-il pas dommage d’avoir à s’arrêter? Cela n’existe pas aux États-Unis!
Je sais qu’aux États-Unis cela n’existe pas. Je le sais d’autant plus pertinemment au vu des propositions que je reçois des États-Unis, d’Australie et d’ailleurs! Mais cela ne m’empêchera pas de rester en France.
Parce que vous êtes une citoyenne?
Oui. Parce que même si j’ai ce côté «recherche sans frontières», je reste attachée à mon pays, j’y ai ma vie, des amis, des relations… Je n’ai pas envie de me couper de tout ce qui m’entoure dans la dernière période de ma vie. Ce qui ne m’empêche pas de voyager beaucoup. Mais chaque chose en son temps. Quand on arrive à un certain âge, comme moi, notre expérience peut servir aux autres. Il faut donc leur en faire bénéficier. Une étude s’est penchée sur l’âge auquel étaient effectués les travaux de recherche qui ont donné lieu à des prix Nobel. Je crois que la moyenne d’âge est de 33ans pour les hommes et de 34ans pour les femmes. Effectivement, pour un chercheur, sa pleine période productive est dans cette zone-là, entre 30 et 40ans. Parce qu’il commence à avoir acquis l’expérience nécessaire pour avoir de nouvelles idées, un fondement de connaissances scientifiques suffisant pour lancer de nouvelles hypothèses, de nouvelles expériences et commencer à connaître toutes les technologies qui sont disponibles. Après, cela redescend, peut-être aussi parce que l’on devient plus «administratif». Donc quand vous dites qu’il n’y a pas d’âge pour être chercheur, je réponds que si, il y a des âges où un chercheur peut être beaucoup plus productif que d’autres.
Cela n’empêche pas les chercheurs les plus âgés de servir, de par leur expérience, aux plus jeunes. Mais il ne faut pas s’imposer aux jeunes générations. C’est probablement dû à ma personnalité, mais j’ai toujours été un peu gênée quand certains chercheurs partaient à la retraite et gardaient un bureau qui était dans le laboratoire où ils travaillaient. Si je déménage, ce n’est pas parce que la direction de Pasteur m’a demandé de déménager. Ils étaient tout à fait d’accord pour que je reste là, ils me l’ont même proposé. C’est moi qui l’ai souhaité. Parce que mon ancien labo est là-bas et que je ne veux pas qu’ils ressentent ce poids. Je ne veux pas être un poids pour eux, je préfère être à distance.
Merci beaucoup, cela a l’air de vous aller bien, en tout cas…
Ce qui ne m’irait pas serait de ne garder aucune activité.
 Françoise Barré-Sinoussi: « La recherche, c’est se donner pour les autres »
Françoise Barré-Sinoussi: « La recherche, c’est se donner pour les autres »