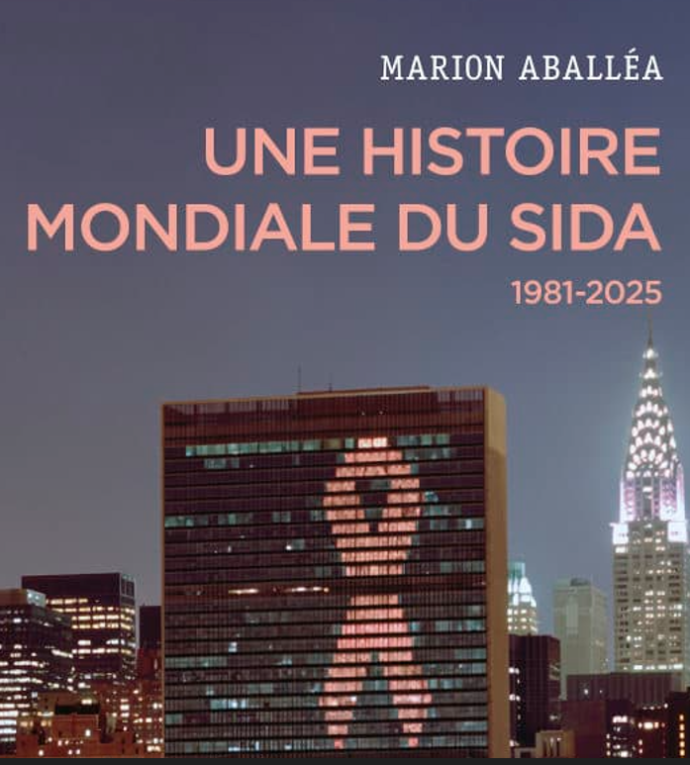Quels points forts retenez-vous des travaux en sciences sociales présentés lors de l’IAS ?
Les sciences sociales ont eu une place discrète durant la Conférence, mais leur importance s’est souvent dessinée en creux. Il fallait en quelque sorte les chercher là où elles n’étaient pas. La conférence d’ouverture d’Esther Duflo tenait du contre-exemple – comme de nombreuses personnes, je reste sceptique quant à la vogue des études randomisées appliquées aux politiques publiques (des financements considérables pour enfoncer quelques portes ouvertes…). L’ironie est d’ailleurs que la Conférence a bien illustré la façon dont les limites des essais randomisés deviennent des questions de recherche à part entière : comment mesurer l’efficacité des stratégies à partir de données produites hors du monde idéal des essais ?
Qu’est-ce que cela peut apporter à de futurs travaux ?
Cette question du real-world commence à beaucoup m’intéresser. C’est une conversation qui a parcouru la Conférence à bas bruit, des déclarations courageuses de Jean-François Delfraissy reconnaissant que la « fin du sida » n’est qu’un slogan déconnecté des contraintes réelles de la lutte aux stands rutilants des firmes de diagnostics (de charge virale, surtout) qui rivalisent désormais de solutions pour le real-world (sous-entendu là où il y a des ruptures de stock et des coupures de courant), en passant par l’intérêt pour les real-world designs.
Mais les nouvelles du monde réel étaient rares : quelques interventions venant d’Afrique centrale, par exemple, pour rappeler les immenses défis logistiques de l’extension du dépistage et du traitement, et les taux ahurissants d’échecs virologiques dès que l’on s’éloigne des capitales. C’est de cela que doivent se saisir les sciences sociales, en partant de l’écart entre les jolies histoires et la matérialité de la lutte – plutôt que de tenter de produire des évidences lisses (l’anglicisme est volontaire) en transposant les approches réductionnistes de la biomédecine.
 IAS 2017 : Quelques nouvelles du « real world »
IAS 2017 : Quelques nouvelles du « real world »