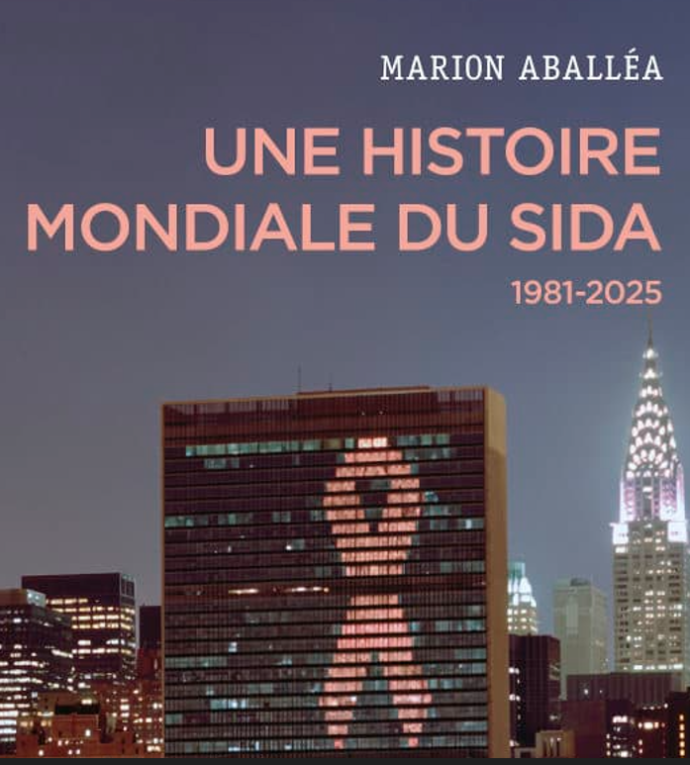Au printemps 1983, une équipe de l’Institut Pasteur découvre le VIH, à l’origine des cas de sida qui se multiplient depuis deux ans. Face au désastre qui s’annonce, ces premiers efforts, portés par un petit collectif, annonçaient déjà ce que serait la lutte à venir.
Début juin 1981, Willy Rozenbaum, infectiologue à l’hôpital Claude-Bernard (Paris), lit le Morbidity and Mortality Weeky Report (MMWR), bulletin hebdomadaire des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC). Dans son édition du 5 juin, l’organisme américain y évoque le cas de cinq jeunes homosexuels de Los Angeles, atteints d’une maladie pulmonaire liée à un champignon, la pneumocystose. Une infection rare, qui ne survient normalement que chez des personnes âgées, ou très immunodéprimées.
L’après-midi du même jour, Willy Rozenbaum reçoit en consultation un jeune homme amaigri, qui se plaint de toux et de fièvre persistantes. Accompagné de son ami, ce steward se rend régulièrement aux Etats-Unis. Le médecin fait aussitôt le lien avec l’article qu’il a lu, et prescrit une radiographie pulmonaire. Le résultat tombera quelques jours plus tard : il s’agit aussi d’un cas de pneumocystose.
Peu après, c’est une autre maladie restreinte aux personnes immunodéprimées, le sarcome de Kaposi, qui émerge à son tour, et à un rythme rapide. Fin août 1981, les CDC recensent déjà 108 cas de pneumocystose et de sarcome de Kaposi chez des homosexuels, pour la plupart vivant à New York ou en Californie. Rejoint par l’immunologiste Jacques Leibowitch de l’hôpital Raymond-Poincaré de Garches, Willy Rozenbaum s’aperçoit que des cas similaires sont déjà traités dans des hôpitaux parisiens. Entre mars et décembre 1982, 29 cas seront recensés lors d’une première enquête, dont 27 dans des hôpitaux franciliens.
Le GFTS s’interroge sur les causes du sida
En février 1982, les deux médecins mettent en place un groupe français de travail sur le sida (GFTS). Parmi cette dizaine d’experts, la plupart âgés d’une trentaine d’années, figurent des infectiologues, des immunologistes, des virologues, un psychiatre… c’est de ce petit noyau de jeunes médecins, bien éloignés du mandarinat, qu’émanera la lutte contre le sida.
En France comme aux Etats-Unis, le sida est considéré comme un épiphénomène, d’autant peu intéressant qu’il touche des personnes encore mal acceptées par la société. En janvier 1982, un premier article paraît dans le quotidien Libération sur un « mystérieux cancer chez les homosexuels américains », mais le public ignore tout du désastre mondial qui se trame. Avant que le terme sida ne se généralise, il sera surnommé le « cancer gay », voire, aux Etats-Unis, la « maladie des 4 H », en raison des publics les plus touchés. Car, outre les homosexuels, d’autres populations sont rapidement atteintes : les héroïnomanes, les Haïtiens et les hémophiles.
Au sein du GFTS, il s’agit notamment de découvrir la cause de cette maladie mortelle. Seront notamment évoquées l’hypothèse des « poppers », ces produits vasodilatateurs utilisés lors des rapports sexuels, celle du cytomégalovirus (CMV)… et, fin 1982, celle d’un rétrovirus. Cette famille de virus a la particularité d’avoir un génome composé d’ARN. Après l’infection cellulaire, celui-ci est ‘rétrotranscrit’ en ADN grâce à une enzyme virale, la « transcriptase inverse ». Mais à ce jour, les rétrovirus ont surtout été étudiés pour leur action dans certains cancers, non dans une immunodéficience.
Le 20 mai 1983, le VIH révélé au monde
L’une des membres du GFTS, Françoise Brun-Vézinet, virologue à l’hôpital Claude-Bernard, se souvient alors des cours qu’elle a suivis avec un spécialiste français des rétrovirus, Jean-Claude Chermann, de l’unité d’oncologie virale de Luc Montagnier à l’Institut Pasteur. Accompagnée par Willy Rozenbaum, elle se rend fin 1982 à l’Institut Pasteur, où elle rencontre les deux hommes, ainsi que la jeune chercheuse Françoise Barré-Sinoussi. Afin de tester l’hypothèse rétrovirale, hospitaliers et pasteuriens décident d’analyser un ganglion d’une personne traitée pour une lymphadénopathie généralisée, un syndrome pré-sida.
Le 3 janvier, l’échantillon ‘BRU’ (selon les initiales du patient) est prélevé à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, puis transporté à l’Institut Pasteur. Quinze jours après la mise en culture, un premier résultat tombe. Françoise Barré-Sinoussi détecte la présence d’une activité RT (pour « reverse transcripse ») dans le milieu de culture qui baigne les cellules. D’autres éléments de preuve suivront rapidement : début février, le microscopiste de l’Institut Pasteur, Charles Dauguet, aperçoit enfin le virus sous sa lunette. En un temps record pour l’époque, les chercheurs disposent au printemps de suffisamment d’éléments pour publier leur découverte. Le 20 mai 1983, sort dans la revue Science l’article inaugural de la recherche sur le VIH, intitulé « Isolation of a T-lymphotropic retrovirus from a patient at risk for acquired immune deficiency syndrome (AIDS) ».
Le lien de causalité entre ce virus et le sida sera notamment étayé par les travaux de David Klatzmann et Jean-Claude Gluckman, immunologistes à la Pitié-Salpêtrière, qui montreront l’effet cytotoxique du virus sur les lymphocytes T CD4+. Mais l’hypothèse est mise en doute par l’Américain Robert Gallo, découvreur en 1980 du premier rétrovirus humain, le HTLV-1. Piqué au vif de s’être fait doubler sur son domaine, le chercheur américain avance la piste d’un autre rétrovirus, le HTLV-3. In fine, il s’avèrera identique à celui trouvé par les chercheurs français, qui seront reconnus comme les vrais découvreurs du VIH. D’abord dénommé LAV (Lymphadenopathy-Associated Virus), le VIH, dont la séquence sera publiée en 1985 par l’Institut Pasteur, ne prendra son nom définitif qu’en 1986.
La découverte du VIH ouvre un « chantier immense »
La découverte de 1983 sonne les débuts de la recherche sur le VIH. « Il y avait tout à faire. Il fallait aller au plus vite pour trouver des tests diagnostiques [ce qui sera effectué en 1984, avec les travaux de la virologue Christine Rouzioux, ndlr], commencer à réfléchir aux traitements et à des candidats vaccins. C’était un chantier immense qui s’ouvrait devant nous. Or nous étions une toute petite équipe, et il était clair qu’il nous faudrait mobiliser d’autres experts, des immunologistes, des biologistes moléculaires, des cliniciens, des virologues hospitaliers », se souvient Françoise Barré-Sinoussi.
En-dehors du laboratoire, l’épidémie naissante frappe toujours plus de personnes, privées de tout espoir une fois que les premiers symptômes apparaissent. En l’absence de traitement dirigé contre le VIH, les médecins sont dans l’incapacité de contrôler celui-ci, et ne peuvent que traiter les maladies opportunistes nées de l’immunodépression. La situation s’étend bientôt au champ social, d’autant qu’elle touche en premier lieu des personnes encore mal acceptées par la société, tels que les homosexuels, les usagers de drogues et les personnes migrantes. Face à l’urgence, ces personnes exigent d’être informées au plus vite des résultats de la recherche. De nouvelles relations entre patients, médecins et chercheurs s’établiront.
Selon Françoise Barré-Sinoussi, « le lien avec les patients s’est fait grâce aux cliniciens, notamment ceux de la Pitié-Salpêtrière et de Claude-Bernard, puis avec l’hôpital Necker, qui prend en charge les enfants et les adolescents. Dès 1984, les contacts ont eu lieu avec le milieu associatif, notamment avec Aides, créée cette année-là. L’association nous a appelés afin que nous venions régulièrement dresser un point d’avancement sur les recherches, au minimum une fois par mois ». Dans bien des cas, le lien fut encore plus direct : « les gens venaient à l’Institut pasteur, directement dans le laboratoire. Nombreux étaient dans un état catastrophique, aussi bien d’un point de vue médical que psychologique », se souvient Françoise Barré-Sinoussi. Il aura fallu attendre 1996 pour que les trithérapies soient enfin disponibles, et que l’infection par le VIH ne soit plus synonyme de condamnation à mort.
Vingt-cinq ans plus tard, en octobre 2008, c’est toujours à l’Institut Pasteur, cette fois-ci à l’antenne de Phnom-Penh (Cambodge), que Françoise Barré-Sinoussi apprendra que le prix Nobel de physiologie ou médecine lui est décerné pour sa découverte du VIH. Un honneur qu’elle partage avec Luc Montagnier… et bien d’autres : selon la chercheuse, « c’était notre prix Nobel à tous, à toute cette communauté qui lutte contre le virus depuis des années ». Une communauté dont les combats sont loin d’être terminés, tant les enjeux scientifiques et humains demeurent nombreux pour éliminer le VIH. Depuis les débuts de l’épidémie, le virus a infecté 84,2 millions de personnes à travers le monde, et en a tué 40,1 millions.
Pour Sidaction, faites un don en appelant le 110 ou en envoyant « DON » par SMS au 92110 ou sur http://sidaction.org
 Il
y a 40 ans, l’Institut Pasteur isolait le VIH
Il
y a 40 ans, l’Institut Pasteur isolait le VIH