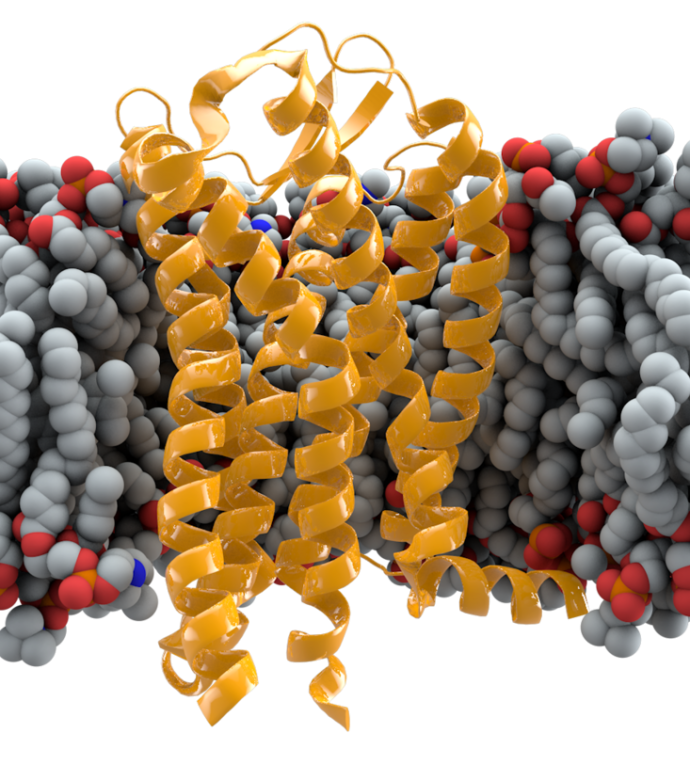L’homme est discret, mais son regard brille avec malice quand il évoque son cœur qui bat à gauche ou chantonne du Bobby Lapointe. On sent la volonté de ne pas trop se livrer, même s’il raconte volontiers son parcours professionnel : ses jeunes années de médecin généraliste et le « critique de l’hospitalo-centrisme » ; sa formation à la prise en charge de l’infection par le VIH, en 1990, quand le discours médical ambiant annonce l’arrivée de patients condamnés ; puis ces patients qui ne franchissent pas la porte de son cabinet, trop habitués à consulter dans les hôpitaux.
Enrôlé à Melun
C’est la drôle de guerre. Alors, en 1996, il propose ses services à la consultation de l’hôpital de Melun (Seine-et-Marne). Il arrive avec les premières trithérapies, le moment est « déstabilisant, mais plein d’espoir ». Le médecin accompagne les effets secondaires, combine les traitements, guide vers une prise en charge esthétique quand la silhouette se modifie brutalement et soigne les autres pathologies. Une médecine de pointe, qui voit le malade dans sa globalité, au-delà du virus. « C’était passionnant. » Parmi ses patients, des homosexuels isolés et beaucoup d’immigrés. Un autre visage de l’épidémie.
Là-bas, il rencontre Bernard Ponge, responsable de la consultation. « Lui, l’engagement médical ; moi, les antécédents gauchistes. » En 2000, ce dernier lui propose de venir consulter dans l’unité de consultations et de soins ambulatoires (Ucsa) au centre de détention de Melun. Depuis la loi de 1994, les soins dans les prisons relèvent des hôpitaux. Ce changement, c’est « l’épidémie qui en est à l’origine ». Des pastilles rouges sur les portes des chambres jusqu’aux patients-experts, il observe la mobilisation et l’émergence d’une « démocratie sanitaire ».
L’engagé du « dedans »
En prison, si les soins et le taux de dépistage à l’entrée ont vite été satisfaisants, il faut bien constater que la différence avec le « dehors » est encore prégnante. Le difficile secret médical, la stigmatisation, les tabous sur le sexe et la drogue, l’absence d’épidémiologie récente. Tout cela rend difficiles les dépistages réguliers, les traitements postexposition ou les initiatives pour distribuer seringues et préservatifs. Ces points négatifs sont les « prochains combats à mener ».
Car s’il est à la retraite depuis 2016, Jean-Luc Boussard reste membre du Corevih Île-de-France Est, où il dirige une commission sur les prisons. Les raisons de cet engagement ? Il n’envisageait pas la médecine autrement. Chez Jean-Luc Boussard, la grandeur est confidentielle.
Avant de partir, il nous siffle quand même deux ou trois choses sur lui : ses patients qui lui manquent, la joie d’être grand-père et le regret de n’avoir pas croisé Barbara, une de ses idoles, qui, elle aussi, œuvra dans l’ombre à faire sortir la maladie de prison.

 Jean-Luc
Boussard : la médecine au violon
Jean-Luc
Boussard : la médecine au violon