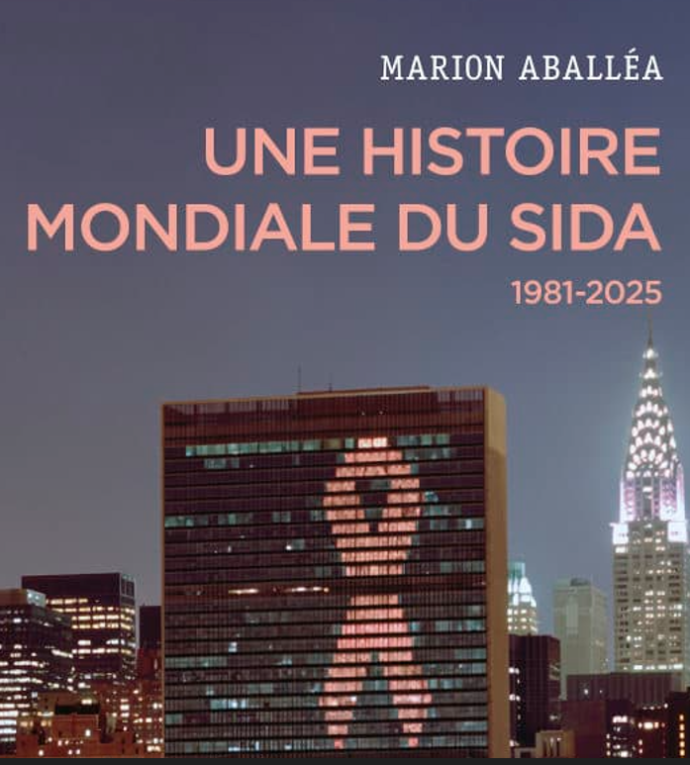L’infection par le VIH, épidémie banalisée ? Certes, en quarante ans, les perspectives de vie ont radicalement changé pour les personnes touchées. Pourtant, le VIH demeure une lutte de tous les jours, aux nombreuses conséquences sociales et psychologiques.
En 2022, vivre avec le VIH ne signifie évidemment pas la même chose qu’en 1982 : jusqu’à l’arrivée des trithérapies, en 1996, l’annonce d’une séropositivité équivalait à une condamnation à mort. Une mort qui survenait en quelques années, voire en quelques mois si le diagnostic était posé au stade sida. Il aura fallu attendre les années 2000 pour que de premières études confirment le retour à une espérance de vie normale des personnes traitées. Quant au risque de transmettre le VIH, il a d’abord été levé pour la transmission de la mère à enfant, puis pour les partenaires sexuels, grâce à la reconnaissance du rôle préventif du traitement anti-VIH à la fin des années 2000 (TasP ou traitement comme prévention).
Assurées de vivre plus longtemps, avec un risque quasi nul de transmettre le VIH si elles sont efficacement traitées, les personnes vivant avec le VIH ont, a priori, tout pour vivre une vie normale. Co-découvreur du VIH, le Pr Willy Rozenbaum, qui exerce à l’hôpital Saint-Louis (Paris), « n’arrête pas de le dire à [ses] patients : “Je peux vous apporter un niveau de santé physique satisfaisant. Peut-être meilleur que la population générale, du fait de votre meilleur suivi médical !” ».
Pourtant, la vie est loin d’être « normale » pour bien des patients, tant les répercussions sociales, professionnelles, psychologiques et affectives du VIH restent profondes. Et la supposée « banalisation » de l’épidémie n’est en réalité qu’un trompe-l’œil. « C’est une situation paradoxale : le sujet s’est en effet banalisé dans la population générale, mais on ne retrouve pas cela au niveau individuel. Chez les jeunes, on entend plutôt des propos tels que “si j’apprends que j’ai le sida, je me suicide” », constate Florence Thune, directrice générale de Sidaction.
Une vie sous antirétroviraux
Moins lourde de conséquences qu’elle ne l’était dans les années 1980, l’annonce d’une séropositivité demeure un choc difficile à accepter. Et inaugure d’emblée une vie passée sous antirétroviraux (ARV). Reposant sur moins de comprimés que par le passé, si les trithérapies rendent la charge virale indétectable, elles ne suppriment pas le sentiment de vivre avec le VIH. Et les nouvelles molécules, plus efficaces et mieux tolérées, ne sont pas exemptes d’effets indésirables, mal supportés par de nombreux patients.
Président d’Act Up-Paris de 1994 à 1996 et rédacteur en chef du site d’informations LGBT+ Komitid, Christophe Martet, lui-même séropositif depuis 1985, reconnaît « ne pas se satisfaire des traitements. J’aimerais prendre un truc et n’avoir plus rien six mois plus tard ! Vivre avec ce traitement, c’est vivre avec l’idée que si je l’arrête, il va se passer des choses vraiment pas terribles. Les gens ne le réalisent pas forcément, mais cela te rappelle quand même à quel point tout cela est fragile ».
Si la recherche fait planer de lointains espoirs de guérison et de rémission, les avancées thérapeutiques se poursuivent. Dernière en date, la commercialisation en décembre 2021 d’un traitement injectable à base de rilpivirine et de cabotégravir, administré tous les deux mois, délivre les patients des comprimés quotidiens. Début février, l’étude française Quatuor révélait l’efficacité d’une trithérapie prise de manière intermittente, à raison de quatre jours sur sept.
De quoi alléger le poids du VIH sur la vie des patients ? Les avis divergent. Selon Christophe Martet, ces avancées constituent une amélioration en termes de tolérance et rendent « la vie un peu plus facile ». « On ne peut le voir que comme un progrès », ajoute Florence Thune, qui y voit « une palette de traitements qui correspond à tout le monde ». Avec les traitements injectables, plus besoin d’ARV à stocker à domicile. Mais ils obligent le patient à retourner à l’hôpital tous les deux mois, ce qui ne convient pas forcément à tous.
Sceptique quant à ces avancées, Willy Rozenbaum estime que « très peu de gens sont intéressés. Dans ma patientèle, qui compte beaucoup de personnes vieillissantes, rares sont celles qui ne prennent que des antirétroviraux. La plupart d’entre elles sont aussi traitées pour des problèmes cardiovasculaires ou d’autres affections. Quand on parle de traitements allégés, cela ne change pas grand-chose, du moment que celui du VIH ne nécessite qu’un comprimé par jour ».
Un poids social et psychologique
Au-delà des traitements, les stigmates psychologiques et sociaux du VIH demeurent tenaces. À quoi s’ajoute, chez les personnes les plus anciennement contaminées, le fait d’avoir survécu à un virus dont elles étaient persuadées mourir. Ce que Willy Rozenbaum qualifie de « deuil du deuil » : apparu à la fin des années 1990, ce phénomène persiste chez les personnes infectées avant l’arrivée des trithérapies.
« Effacer ce poids n’est pas si facile, des patients n’arrivent toujours pas à croire qu’ils auront une espérance de vie normale avec le VIH », explique le professeur. « Nombre de patients souffrent en plus de discriminations, lesquelles engendrent des difficultés à parler du VIH et empêchent de vivre la situation de manière apaisée. Et bien que cela ait un peu changé, cela demeure une vraie souffrance pour beaucoup d’entre eux », constate-t-il.
En outre, le VIH continue d’être un marqueur fort de vulnérabilité sociale. Par exemple, les migrants, frappés par des restrictions d’accès aux soins toujours plus sévères. « Nous avons de plus en plus de mal à assurer la prise en charge des patients originaires d’Afrique subsaharienne, juge Willy Rozenbaum. Ces problèmes d’inégalité d’accès aux soins ont un impact individuel sur les personnes, mais aussi collectif sur la société. » Selon Christophe Martet, les autorités « parlent de lutte contre les discriminations et la précarité, mais que fait-on vraiment pour les migrants ? Les lois sur l’immigration leur rendent la vie toujours plus compliquée. Face aux politiques sécuritaires, la lutte contre le sida a rarement le dernier mot ».
Une crainte de transmettre persistante
En matière de prévention, l’intérêt du TasP a certes révolutionné la lutte contre le sida, en révélant aux personnes vivant avec le VIH que le risque de contaminer leur partenaire devenait inexistant en cas de charge virale contrôlée. Néanmoins, l’évidence scientifique peine à s’imposer en pratique. Selon Florence Thune, « des personnes ont du mal à avoir confiance dans ces résultats, d’autant que certains médecins peu informés leur disent encore “mettez un préservatif, on ne sait jamais” ». Pour Willy Rozenbaum, le poids historique de l’épidémie continue, là aussi, à se faire sentir : « De nombreux patients ont passé une partie de leur vie avec l’appréhension de transmettre le virus. »
De plus, chaque progrès médical a son revers, rappelle Florence Thune : « Tous ces progrès engendrent aussi une injonction à dire les choses de manière positive. Ce qui n’est pas facile pour ceux qui ont encore des effets secondaires avec leur traitement ou qui ne vivent pas bien leur séropositivité. » À la distinction persistante entre les personnes séropositives et séronégatives s’est ajoutée celle entre les personnes dont la charge virale est indétectable ou non. « Attention à ne pas créer une nouvelle discrimination entre ceux et celles qui, d’une part, seraient « les bons élèves » et d’autre part ceux dont la charge virale reste détectable, quelle qu’en soit la raison », prévient la directrice de Sidaction.
Pour Sidaction, faites un don en appelant le 110 ou en envoyant « DON » par SMS au 92110 ou sur http://sidaction.org
 La vie avec le VIH, toujours
un combat quotidien
La vie avec le VIH, toujours
un combat quotidien