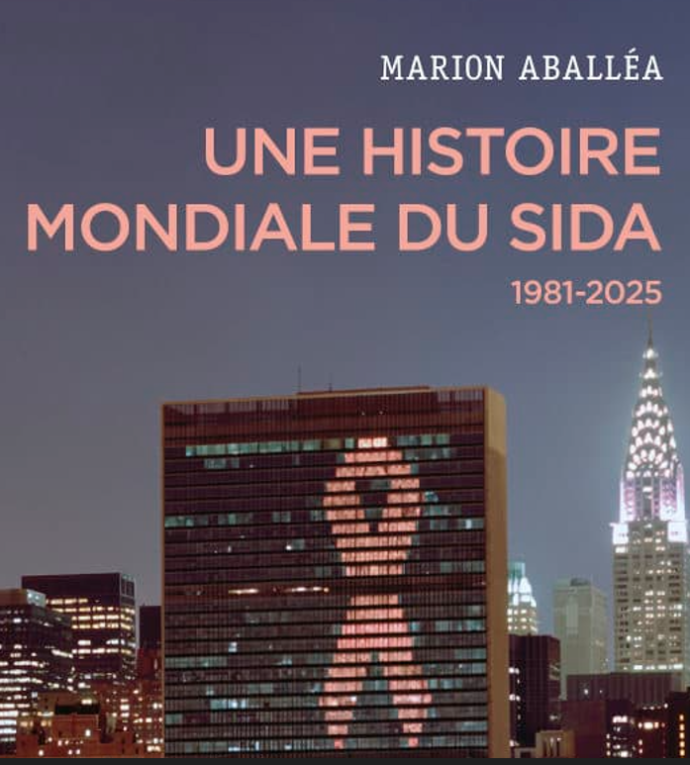Quand vous avez commencé à travailler sur cette question, en 2008, quels étaient les enjeux autour du sport pour les personnes infectées ?
Le discours sur le fait qu’il fallait pratiquer un sport était très présent et assez consensuel de la part du milieu associatif et médical. Ils présentaient cela comme une évidence, en étant peu conscients des difficultés que présente l’accès à des pratiques sportives et des motifs pour lesquels les personnes n’y allaient pas, voire interrompaient leurs activités. Nous nous sommes donc intéressés à ce que le diagnostic du VIH provoque dans le rapport au corps, aux activités physiques existantes ou dans la possibilité de s’engager là-dedans.
Qu’avez-vous découvert ?
Il existe deux profils : ceux qui se plient à cette injonction [faites du sport] et ceux qui y résistent. Quand bien même les gens acceptent de pratiquer une activité physique, ils rencontrent des difficultés à trouver des dispositifs adaptés à leur problématique, et ce, pour des raisons tant sociales que médicales : la question de dire sa séropositivité ou la peur du contact de l’autre par exemple, des questions qui ne sont pas liées à des dimensions biologiques. Il s’agit de raisons souvent profondes et difficiles à cerner.
Quelles sont les principales résistances à la pratique sportive ?
La première est liée à la visibilité : exposer son corps, c’est risquer de se rendre visible et d’être interrogé. Quand on pense qu’il y a des stigmates ou des signes physiques de la maladie sur son corps, s’engager dans des univers de sociabilité, plus ou moins importants collectivement, peut être un obstacle extrêmement important. Certaines personnes ont alors tendance à se tourner vers des pratiques individuelles. La deuxième concerne l’évolution de ses capacités corporelles. Après l’annonce, il y a souvent un effet de sidération qui signe l’arrêt de toute pratique. Il faut tout un parcours pour que les patients se disent que ça va durer [être en vie] et qu’il faut s’organiser dans le temps. Certains vont alors s’engager dans une pratique physique un peu brutale et violente. Ils font du sport pour lutter contre le virus, pour l’expulser, pour le transpirer. C’est aussi lié à la visibilité, car arrêter son activité physique, c’est susciter des questions, alors que s’adonner à une suractivité physique, être en bonne forme, c’est éviter des interrogations auxquelles on ne veut pas répondre.
Quel rôle a joué l’évolution des traitements sur ce sujet ?
Pour certaines personnes, on pouvait avoir l’impression que tout allait bien grâce aux nouveaux traitements, mais, en même temps, ces derniers les maintenaient dans une fragilité sociale et leur donnaient des armes pour cacher leur état et créer des situations sociales parfois compliquées à gérer. Des situations plus problématiques que lorsque les personnes présentaient un stigmate visible et qu’elles étaient obligées de parler du VIH. Il y a l’illusion que l’invisibilité biologique permet l’invisibilité sociale et que c’est une bonne chose. Évidemment, elle est positive dans le sens où les gens peuvent vivre plus longtemps. Mais en cherchant à tout prix l’invisibilité, la maladie reste au centre de la vie, il faut élaborer des stratégies constamment. Pour les personnes qui sont très dépendantes d’un milieu social où elles ne peuvent pas le dire, comme les migrants, elles se retrouvent dans des situations non pas de vulnérabilité physique, mais de vulnérabilité sociale.
Après avoir fait ce constat, quelles solutions envisager ?
Il s’agit déjà de se rendre compte qu’un discours pensé pour aider peut produire beaucoup de culpabilité et être contre-productif. À mon sens (mais je suis là pour mettre en avant des processus et non pour conseiller), travailler sur la stigmatisation et sensibiliser le milieu sportif ordinaire aux questions liées au VIH sont des fondamentaux
 Sensibiliser le milieu sportif ordinaire
Sensibiliser le milieu sportif ordinaire