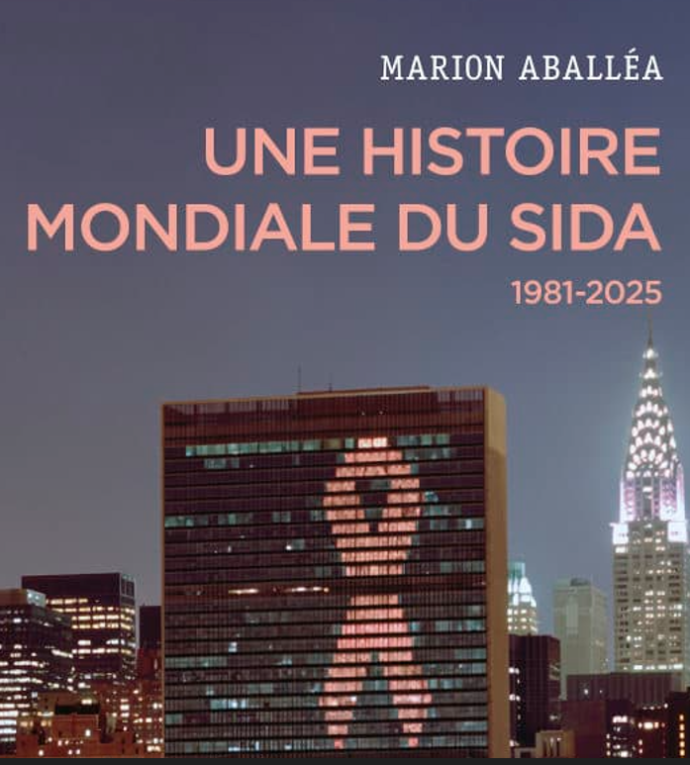Le dépistage est le premier des objectifs « 90-90- 90 » de l’Onusida [1], à savoir, d’ici à 2020, que 90% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur état sérologique. Nous sommes loin du compte. Certes, les chiffres sont en progression constante : en 2017, 75% des personnes vivant avec le VIH dans le monde connaissaient leur statut, alors qu’elles n’étaient que 66% en 2015.
Mais ces statistiques globales cachent de grandes disparités. Exemple en Afrique subsaharienne : dans les pays situés à l’est et au sud du continent, 81 % des personnes atteintes par le VIH ont été diagnostiquées alors qu’en Afrique de l’Ouest et centrale, moins d’une personne touchée sur deux (48%) sait qu’elle est infectée par le virus. Et à l’intérieur même de cette région, les différences entre les pays sont énormes : ainsi, les personnes vivant avec le VIH sont 88% à connaître leur statut au Burkina Faso et 71% au Cameroun, mais seulement 38% au Nigeria et 32% au Congo.
Lever les freins au dépistage
En Afrique, les obstacles au test du VIH sont nombreux : manque d’information et de conscience individuelle du risque, éloignement géographique des centres de dépistage et coût des déplacements trop important, peur de la stigmatisation, etc.
Les innovations récentes dans les outils de dépistage, notamment l’autotest ou les technologies de diagnostic précoce des nourrissons, sont susceptibles d’augmenter le nombre d’adultes et d’enfants testés, à condition qu’elles soient disponibles partout. Mais même si c’était le cas, ces avancées techniques ne seraient pas suffisantes. Il faut une palette de services de dépistage pour toucher le plus grand nombre de personnes, comme l’explique Mach-Houd Kouton, qui était, il y a peu, conseiller régional de l’Onusida en Afrique de l’Ouest et centrale.
« Le test [du] VIH est encore essentiellement proposé dans les hôpitaux ou les centres médicaux. Tout d’abord, au sein même des hôpitaux, la proposition de dépistage doit être davantage ciblée, par exemple dans les services qui prennent en charge les enfants mal alimentés ou dans certains services pour adultes. En parallèle, il faut multiplier les possibilités de dépistage “hors les murs”, au plus proche des lieux de vie. Cette stratégie doit s’accompagner d’un développement du dépistage communautaire, notamment pour mieux répondre aux besoins des populations clés : hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes [HSH], travailleur·euse·s du sexe, usagers de drogues… » Une approche déjà mise en place localement par les associations de personnes vivant avec le VIH, en particulier celles que Sidaction soutient. « Jusqu’à récemment, le dépistage offert par ces associations était assuré par des professionnels de santé, car les législations des pays interdisaient à des personnels non médicaux de le faire, précise Mach-Houd Kouton. Nous avons travaillé pour faire évoluer les lois, c’est en cours dans plusieurs pays : l’objectif est de former de nombreux travailleurs communautaires afi n de démédicaliser le dépistage et de permettre un accès au test du VIH à grande échelle. » Autre stratégie que l’Onusida préconise de développer « dans une démarche de volontariat et dans le respect des droits de la personne », insiste Mach-Houd Kouton : offrir un dépistage du VIH et des conseils aux membres de la famille (y compris les enfants) et aux conjoints des personnes diagnostiquées séropositives. Une étude menée au Kenya a montré que la proportion d’hommes acceptant un test de dépistage avait doublé dans le cadre de cet accompagnement familial.
En France, une analyse fine par régions
En France, si le recours au test du VIH est important (5,4 millions en 2016), les personnes touchées ne sont néanmoins pas forcément celles qui se font dépister. Chercheuse en épidémiologie à l’Inserm, Virginie Supervie travaille sur « l’épidémie cachée », autrement dit les personnes non diagnostiquées : en 2014 (derniers chiffres disponibles), elles étaient 24 000, dont 10 000 en Île-de-France. « Avant nos travaux, explique la chercheuse, nous ne disposions que d’estimations au niveau national. Nous apportons des informations beaucoup plus fines sur les personnes non diagnostiquées dans chaque région, voire chaque département : quels sont les groupes de transmission les plus représentés, la proportion d’hommes et de femmes, la zone géographique d’origine des personnes concernées nées à l’étranger, etc. L’intérêt est d’aider les acteurs locaux à adapter leurs programmes en fonction des populations les plus affectées dans leur région : ils peuvent ainsi proposer des offres de dépistage mieux ciblées afi n d’être plus effi caces localement. »
Logiquement, le plus grand nombre de personnes non diagnostiquées se trouve en Île-de-France, où l’épidémie cachée regroupe majoritairement des hommes homosexuels ainsi que des femmes et des hommes hétérosexuels originaires d’Afrique subsaharienne. La région PACA, où l’épidémie non diagnostiquée est un peu plus masculine, et Auvergne-Rhône-Alpes sont les deux autres régions les plus concernées. « Ces trois régions cumulent plus de 50 % de la totalité des personnes non diagnostiquées », précise Virginie Supervie. Mais si l’on s’intéresse à la proportion de personnes non dépistées par rapport au nombre d’habitants de la région étudiée, la Guyane est le département le plus touché, avec un taux dix fois supérieur à celui de la France métropolitaine. Viennent ensuite la Guadeloupe, l’Île-de-France et la Martinique.
Le non-recours au dépistage a bien sûr des conséquences pour les 24 000 personnes qui ignorent leur séropositivité. « Le délai entre leur infection par le VIH et le diagnostic est long, autour de trois ans en médiane, souligne Virginie Supervie. Au cours de cette période, il existe un risque de transmission du virus aux partenaires, mais, surtout, c’est une perte de chance pour la personne qui n’a pas accès au traitement pendant tout ce temps. »
[1] – À l’horizon 2020, 90 % des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique, 90% de toutes les personnes infectées par le VIH dépistées reçoivent un traitement antirétroviral durable et 90% des personnes recevant un traitement antirétroviral ont une charge virale
durablement supprimée.
 Vers une révolution, du dépistage
Vers une révolution, du dépistage