Dans un rapport essentiel paru l’année dernière, le Conseil national du sida et des hépatites virales (CNS) faisait le point sur l’exposition et la prise en charge de l’hépatite C en prison. Prévention, réduction des risques, dépistage, traitement, suivi de sortie… Un an après sa sortie, retour sur les mécanismes freinant l’éradication de la maladie chez les personnes détenues.
Le 26 septembre 2019, le Conseil national du sida et des hépatites virales (CNS) adoptait un avis, suivi de recommandations, sur la prévention, le dépistage et le traitement de l’hépatite C chez les personnes détenues. Ce travail faisait suite à un an d’enquête effectuée par une douzaine de membres du CNS. « On a choisi trois régions, explique Hugues Fischer, membre du CNS, le Grand Est, la région PACA et l’Ile de France. Là-bas, on a rencontré plusieurs acteurs directement impliqués dans la prise en charge de l’hépatite C en milieu carcéral. »
À l’origine de ce rapport, une demande initiée par le directeur de l’administration pénitentiaire, le directeur général de la santé ainsi que par la directrice générale de l’offre de soins, tous deux désireux de comprendre ce qu’a changé l’arrivée des Antiviraux d’action directe (AAD) dans le traitement de la maladie. Une occasion, aussi, de faire un point sur l’objectif du gouvernement d’éradiquer entièrement l’épidémie d’Hépatite C en France d’ici à 2025.
Pour atteindre ce but, la prise en compte de la population carcérale est effectivement essentielle. Une prévalence du VHC est encore largement constatée auprès de ce public, même si le nombre de malades tend à diminuer autant dans la population générale que chez les détenus.
Test and treat
Dans ce rapport, le CNS propose un état des lieux de la prise en charge par les AAD des patients infectés par le VHC en milieu pénitentiaire et propose des pistes d’améliorations afin de contribuer à la stratégie d’élimination du virus. Hasard du calendrier, sa publication, quelques mois avant le début de l’épidémie du COVID-19, n’a pas favorisé l’application de ses recommandations.
Hugues Fischer explique qu’« il est difficile de savoir en amont les répercussions qu’auront un tel rapport. Une personne qui s’en saisit peut suffire à faire évoluer les choses. Mais il peut aussi simplement prendre la poussière. Ce n’est pas pour autant qu’il ne faut pas faire ce travail ! D’ailleurs, on le fait aussi pour nos camarades du secteur associatif et on les encourage à se pencher dessus ! »
Depuis 2014, l’arrivée d’Antiviraux d’action airecte (AAD) a en effet révolutionné la prise en charge de l’hépatite C : plus efficaces et mieux tolérés, ils permettent, dans la majorité des cas, d’arriver à bout de la maladie après un traitement de huit à douze semaines. Une offre thérapeutique efficace qui ne nécessite qu’une chose pour être appliquée : un bon dépistage. C’est le fameux « test and treat ».
« S’il n’y a pas de dépistage, il n’y a pas de soin, précise Catherine Fac, médecin coordinatrice à l’Unité santé en milieu pénitentiaire (USMP) de Fresnes. Quand le traitement est pris correctement, il y a un taux de guérison de 100% ». Pour elle, le dépistage est donc primordial et « celui-ci doit être réalisé précocement car la majorité des détenus sont là pour des peines courtes et on risque de perdre l’occasion de les traiter avant leur sortie. Le temps de la détention est favorable au traitement, les détenus ne sont pas pris par les préoccupations du quotidien comme manger ou trouver un logement. »
Tous les détenus qui arrivent en centre pénitentiaire se voient proposer un dépistage. Dans la majorité des cas, ces derniers acceptent. « À Fresnes, si le résultat est positif, explique Catherine Fac, on complète le bilan de santé de la personne concernée et s’il n’y a pas de facteurs de comorbidité, alors on lance le traitement. Notre problème, c’est si le patient est libéré avant la fin du traitement. Dans ce cas on lui laisse une boite mais toujours avec une question en tête : va-t-il terminer son traitement ? »
« En sortant de prison, la priorité n’est pas le soin »
Pour Florence Huber, médecin infectiologue à la Croix-Rouge en Guyane et ancienne médecin à l’Unité Sanitaire du Centre pénitentiaire de Rémire Montjoly, cette question du post carcéral est la clé. « J’ai mis deux ou trois ans pour réaliser que le gros défi sur la question de l’accès aux soins en milieu pénitentiaire, c’était la sortie. La rupture du suivi est importante. Ici, en Guyane, on a essayé de renouer avec le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP), afin de mieux préparer les sorties. Grâce à ça, les choses s’améliorent doucement. Quand on sort de prison, outre la maladie, il y a beaucoup d’autres raisons de mourir : overdose, suicide… La priorité des personnes qui sortent de prison n’est pas le soin ! »
Plus que de cibler cette problématique de la sortie de prison, Florence Huber appelle à développer la recherche sur le post carcéral, « au niveau des études interventionnelles nous sommes au point zéro ! C’est un milieu complexe avec beaucoup d’acteurs mais il y a beaucoup d’expériences, notamment aux États-Unis, qui ont montré des choses probantes. Ils ont notamment des accompagnants dedans / dehors ! »
Un constat appuyé par Catherine Fac qui juge que le personnel médical, essentiellement accaparé par le soin, ne peut pas prendre le temps de l’étude. Or, il est impossible d’élaborer une stratégie précise sans chiffres : « aucun sujet ne fait réellement l’objet d’études en prison alors nous essayons de passer par nos internes en leur proposant de réaliser des données chiffrées, dans le cadre de leur thèse. On parle énormément de séroconversion [i] durant la détention mais elle n’a jamais été réellement quantifiée ! Y a-t-il une séroconversion ? Si oui, à quel moment de la détention ? Par quel biais les détenus sont-ils contaminés ? On a toujours aucune donnée ! »
À chaque centre sa stratégie
Ce manque de chiffres rend plus difficile la mise en place d’une stratégie commune, ce qui explique la multiplicité des prises en charge selon les établissements pénitentiaires : « En Occitanie par exemple, il y a 15 prisons et autant de manières de faire. Cela dépend beaucoup de la direction, du médecin, de l’engagement du personnel infirmier… », constate André-Jean Rémy, médecin de l’unité sanitaire de Perpignan.
Selon Hugues Fischer, l’organisation dans les centres pénitentiaires est très « ‘personne dépendant’ alors qu’il devrait y avoir des règles qui s’appliquent à tous. » En filigrane, c’est l’épineuse question de la Réduction des risques (RDR) en direction des usagers de drogues, un « vieux serpent de mer » comme il la définit, qui se pose. La mise à disposition de matériel d’injection afin d’éviter les contaminations est bien installée en milieu ouvert mais de manière beaucoup plus aléatoire au sein des USMP.
Même constat pour l’utilisation des TROD, les Tests rapides d’orientation diagnostique, dans la lutte pour le dépistage. L’utilisation des TROD permettant pourtant de faciliter le dépistage du fait de sa rapidité et de la réduction du nombre de rendez-vous entre détenus et personnel soignant qu’il induit.
Si les enjeux sont encore nombreux pour parvenir à une amélioration globale de l’accès aux soins en prison, Hugues Fischer rappelle les changements déjà opérés au cours des vingt dernières années permettant « à la santé en milieu carcéral de plutôt bien se porter depuis la réforme Kouchner de 2002. »
Prochain levier du CNS : le colloque VHC en prison, prévu initialement le 2 novembre 2020 et reporté en raison de la crise sanitaire. L’occasion, pour Hugues Fischer, de venir « titiller la direction des ministères » en vue d’une prise en compte concrète et généralisée des recommandations préconisées par le CNS.
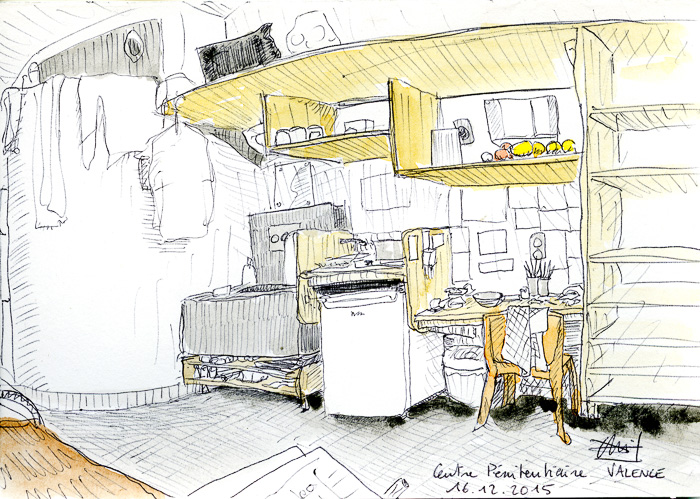
[i] Contamination à l’hépatite C
 VHC en
prison : un an après le rapport du CNS, où en est-on ?
VHC en
prison : un an après le rapport du CNS, où en est-on ? 







